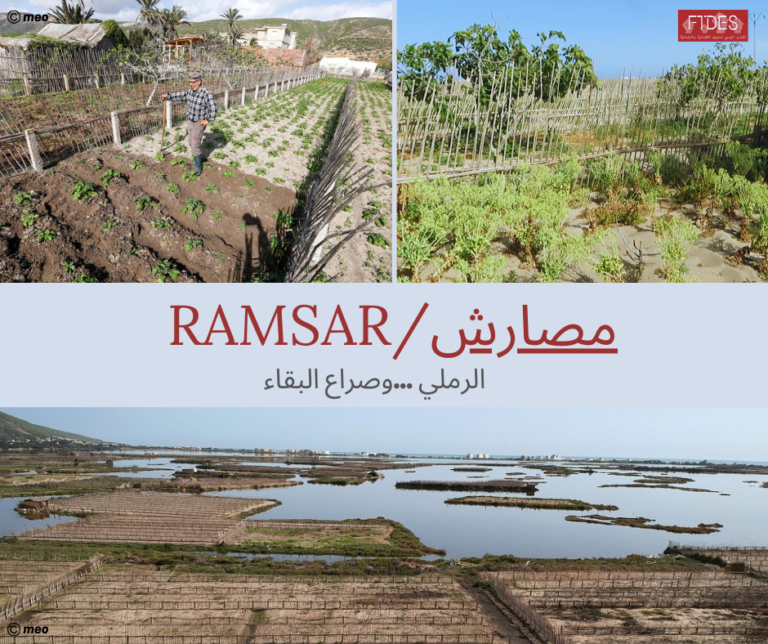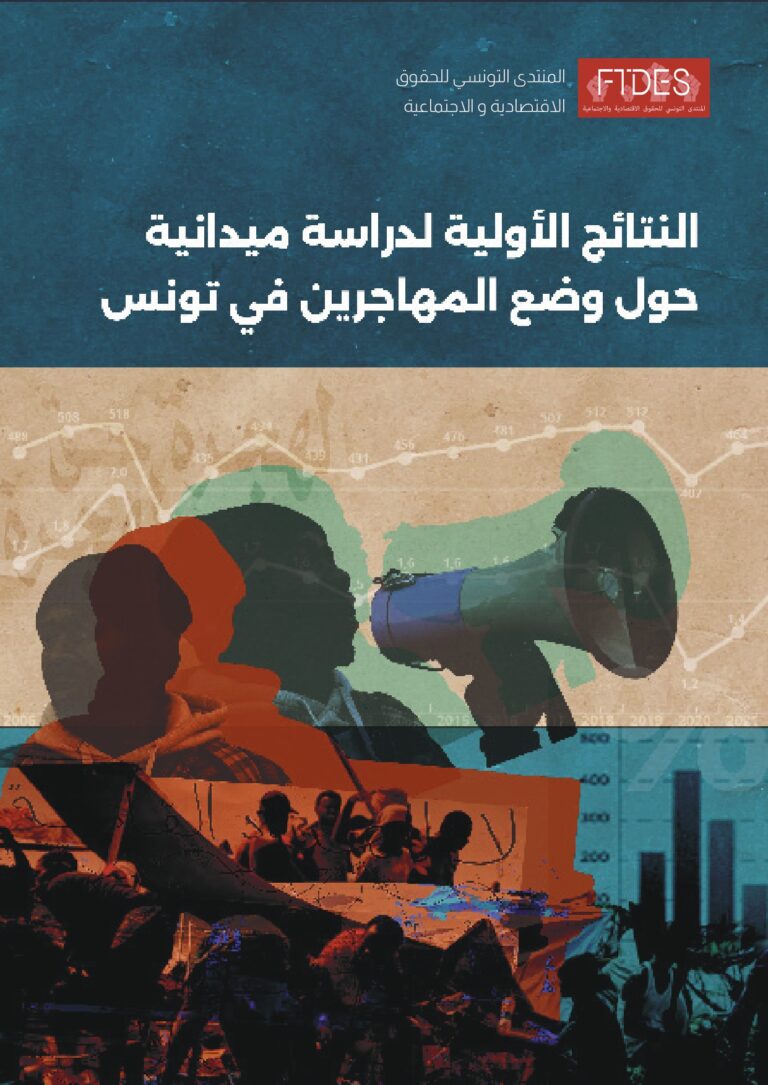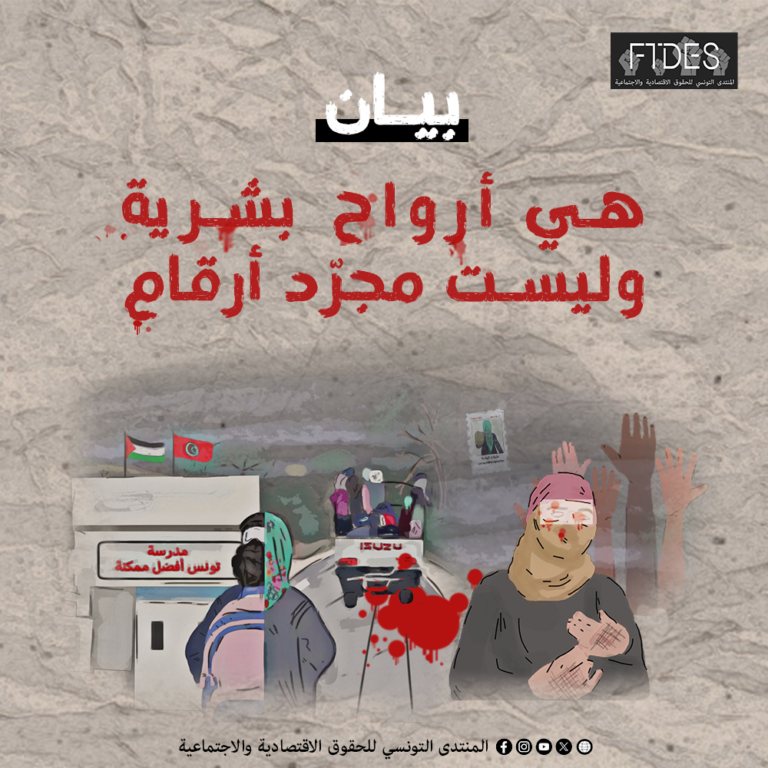Financements 2024
Résultats préliminaires d’une étude de terrain sur la situation des migrants en Tunisie
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
Enquête de terrain sur la situation des migrant.es en Tunisie : résultats quantitatifs préliminaires
Juillet 2024
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a réalisé une étude de terrain sur la question migratoire sous la direction d’une équipe de chercheurs. L’étude repose sur des méthodes quantitatives et qualitatives allant des entretiens semi-directifs aux focus groupes. De mars à mai 2024, l’enquête a été réalisée avec un échantillon de 379 migrant.es, dans trois gouvernorats : Tunis, Sfax et Médenine.
Dans un contexte local et régional complexe et critique, cette étude de terrain a examiné cinq axes clés :
- Parcours et conditions d’arrivée
- Conditions de séjour en Tunisie
- L’accès aux droits fondamentaux
- Relations sociales et rapports à autrui
- Interactions avec les institutions publiques et les acteurs de la société civile.
Ce qui suit est une présentation préliminaire des caractéristiques générales de l’échantillon et des résultats descriptifs clés des thèmes de l’étude. L’équipe de recherche publiera régulièrement les résultats de la base de données sous la forme de documents analytiques, d’articles et d’infographies à partir du mois de septembre prochain.
- Portrait général de l’échantillon
L’échantillon était constitué de 72,1 % d’hommes et de 26,9 % de femmes, 64 % étaient âgées de 18 à 28 ans, 5 % étaient mineures et la moyenne d’âge se situait à 26 ans.
9,5 % des personnes interrogées ne savent ni lire ni écrire, tandis que 28 % de l’échantillon a un niveau d’éducation avancé.
Les migrant.es ayant participé à l’étude provenaient de 23 pays africains. Selon l’échantillon interrogé, le Soudan est en tête (14,2%), suivi de la Guinée Conakry, tandis que la Mauritanie, l’Éthiopie et l’Érythrée sont les derniers pays en nombre de migrant.es sur le sol tunisien.
Les migrant.es en situation irrégulière représentent 62,8 % des personnes interrogées, tandis que les demandeurs d’asile représentent 25 %.
Près de 30 % des participant.es poursuivaient leurs études dans leurs pays d’origine avant de partir, et 14 % d’entre eux étaient employés de manière permanente.
- Parcours migratoire et conditions de vie en Tunisie
Les raisons de la migration sont complexes, en particulier politiques et économiques. A la tête de ces motivations sont les régimes oppressifs (66 %), suivis du changement climatique (54 %).
Les migrant.es sont arrivé.es en Tunisie par la frontière terrestre avec l’Algérie pour plus de 60 % des cas et par voie terrestre via la Libye pour plus de 23 %, ce qui fait de la frontière terrestre le principal point de passage pour plus de 83 % des migrant.es.
Une fois arrivées en Tunisie, 45 % des personnes interrogées disent avoir poursuivi leur voyage migratoire à pied.
12 % des personnes interrogées sont accompagnées d’au moins un ou plusieurs enfants à leur charge.
Actuellement, 52% des personnes interrogées sont sans emploi.
75 % des personnes interrogées ont été contraintes à changer de domicile à plusieurs reprises en Tunisie au cours de l’année passée, la principale raison étant d’éviter les contraintes de sécurité, suivie de la violence des habitants des régions où elles s’étaient installées auparavant et de la recherche de régions plus accueillantes pour les migrants. Actuellement, plus de la moitié des personnes interrogées vivent dans des conditions précaires et indignes (rues, parcs, tentes, en plein air, etc.).
Depuis leur arrivée en Tunisie, 77 % des migrant.es disent avoir été victimes d’une ou plusieurs formes de violence. La première forme de violence envers les migrants est la violence verbale (67% au moins une fois), suivie de la violence physique (56,7% au moins une fois). Selon eux, ces violences émanent principalement de « groupes de délinquants ». Lorsqu’ils sont victimes de violences en Tunisie, seulement 5 % des migrants disent avoir déposé une plainte, tandis que 40 % des victimes de violences s’abstiennent de le faire en raison de leur statut administratif et 12 % parce qu’ils ne connaissent pas les démarches à suivre.
Les migrants font face à divers problèmes dans leurs environnements actuels d’habitation, tels que la violence entre migrants, l’impossibilité de communiquer avec leurs familles dans leurs pays d’origine, ainsi que la violence exercée par des Tunisiens.
40,1 % des migrant.es ne disposent pas d’accès à l’eau potable et près de 70 % affirment connaître des migrants en manque de nourriture.
Face à des soucis de santé, les personnes interrogées se rendent fréquemment à la pharmacie (65,2%) ou utilisent des méthodes traditionnelles de traitement (56,5%). Les personnes interrogées se sont rendues au moins une fois à un hôpital public dans seulement 14 % des cas, à une clinique privée (12 %) ou à un cabinet de médecin (7%) (choix multiples / réponse par “au moins une fois”).
La situation financière (93%) et la crainte d’être arrêté (90%) sont les principales difficultés auxquelles les participants font face pour accéder aux soins de santé. (choix multiples / réponse par “d’accord”)
Les Tunisien.nes et les communautés hôtes sont à la tête de la liste des acteurs locaux ayant apporté une aide en nature aux migrants, suivi.es par les autorités tunisiennes.
- Perspectives et facteurs déterminants du parcours à travers la Tunisie
Sur les motifs du choix de la Tunisie comme destination, les participant.es se sont exprimé.es comme suit: (choix multiples / réponse par “d’accord” et “plus ou moins d’accord”)
- Ce n’était pas un choix:
75,2% parce que forcé vers les frontières tunisiennes à contre gré
59,4% parce que obligé de fuir la violence dans un pays voisin
59,3% parce que obligé de fuir le pays d’origine
- Réseaux et contacts:
62% pour le réseau de connaissances qui aideraient à vivre en Tunisie
49,8% pour le réseau de connaissances qui aideraient à traverser vers l’Europe
43,7% pour contacter les organismes internationaux
- Situation en Tunisie:
46,4% possibilité de trouver du travail
33,3% stabilité sécuritaire
Plus de 30 % des personnes interrogées ont tenté de traverser vers l’Europe depuis la Tunisie au moins une fois au cours de l’année écoulée. Un tiers des personnes qui ont essayé de le faire ont été témoins du naufrage du bateau. 53,8 % des personnes interrogées disent connaître d’autres migrant.es qui se sont noyé.es ou sont porté.es disparu.es.
Quand interrogées sur leurs plans futurs, les participant.es pensent au retour à leur pays d’origine à 42 %, tandis que 79,2 % ont exprimé leur souhait de traverser vers l’Italie. (choix multiples / réponse par “oui”)
Sur les facteurs d’attractivité (pull factors) de la Tunisie, les participant.es se sont exprimé.es comme suit ((choix multiples / réponse par “d’accord”)
30,1% possibilité de travailler en Tunisie comparé à d’autres pays
35,4% se sentir bien en Tunisie
53,6% impossibilité de retour au pays d’origine
45,6% l’attente de l’occasion de traverser vers l’Italie (17% ont refusé de répondre sur ce choix)
34,8% l’attente du retour à la stabilité dans un autre pays
Sur les facteurs de répulsivité (push factors) de la Tunisie, les participant.es se sont exprimé.es comme suit: (choix multiples / réponse par “d’accord” et “plus ou moins d’accord”)
67,5% le sentiment d’insécurité
60,7% si traverser vers l’Italie n’est plus possible
80,2% maltraitance des autorités
62,5% maltraitance des organismes onusiens
Les individus interrogés estiment que les Tunisien.nes ne seraient pas en faveur d’une régularisation massive de la situation des migrant.es en raison de (dans l’ordre) : manipulation de l’opinion publique et désinformation dans les médias et sur les réseaux sociaux, situation économique en Tunisie, et enfin le racisme.
Note de Presse [FR] – Juillet 2024.
FTDES. 2024. Tous Droits Réservés
.