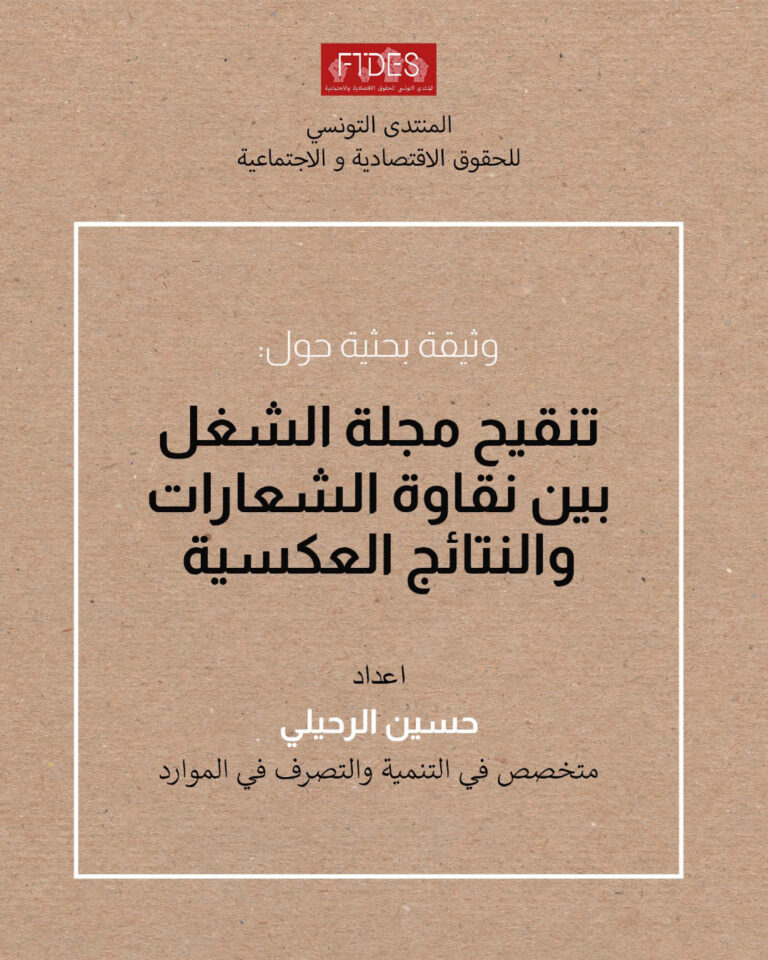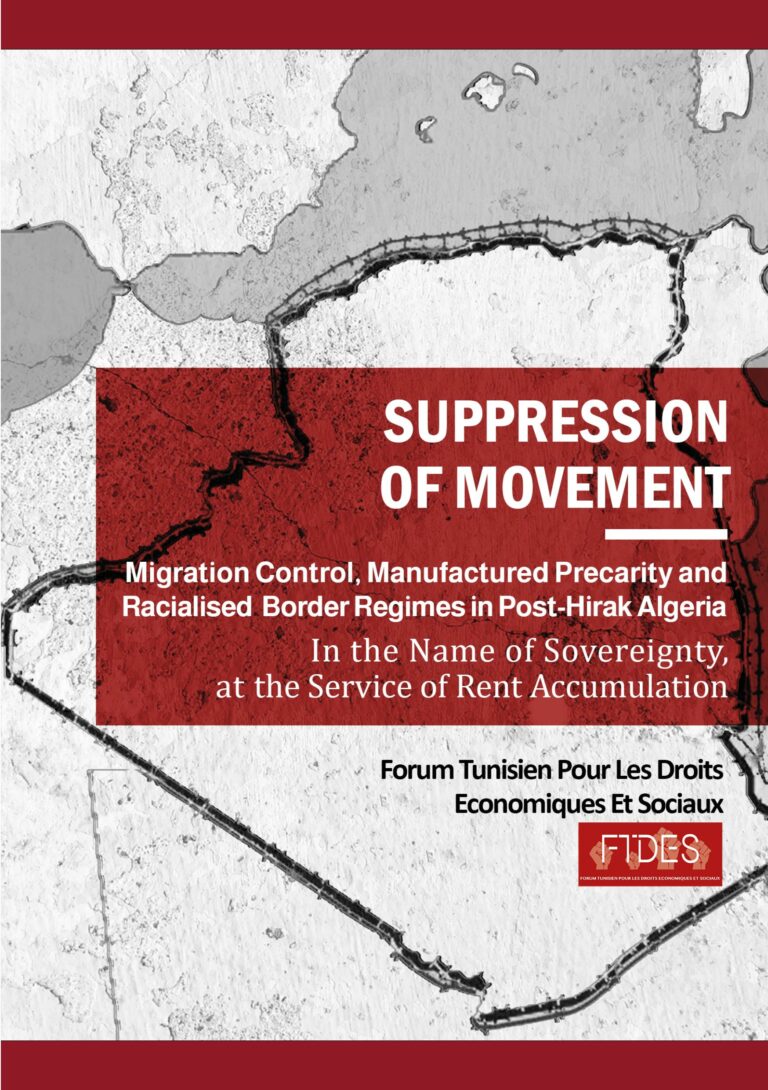L’acharnement contre les navires de recherche et de sauvetage cause des centaines de morts en mer
L’acharnement contre les navires de recherche et de sauvetage cause des centaines de morts en mer
32 organisations exigent que l’Etat italien cesse immédiatement les entraves systématiques opposées aux opérations de recherche et de sauvetage (SAR) menées par des organisations non gouvernementales. Au cours du mois dernier, des navires d’ONG ont été immobilisés à trois reprises en raison de restrictions légales fondées sur des allégations relevant du « décret Piantedosi ». L’un d’entre eux, le navire de surveillance Nadir de l’ONG RESQSHIP, a été immobilisé à deux reprises. Le fait de délibérément tenir à distance les organisations non gouvernementales de recherche et de sauvetage de la Méditerranée centrale entraîne d’innombrables décès en mer sur l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde.
Malgré les nombreuses alertes lancées par les organisations SAR, les navires des ONG continuent d’être arbitrairement immobilisés depuis l’adoption du « décret Piantedosi » en janvier 2023, aggravée par la conversion en loi du « décret Flussi » en décembre 2024. Au cours du mois dernier, les petits navires de RESQSHIP et de Sea-Eye, le Nadir et le Sea-Eye 5, ont été immobilisés, accusés de ne pas avoir respecté les instructions des autorités. Les deux équipages ont reçu des ports très éloignés pour le débarquement des personnes survivantes et ont été invités à procéder à des transbordements partiels de personnes sur la base de critères de vulnérabilité, alors qu’une évaluation fiable de la vulnérabilité nécessite un environnement sûr et ne peut être effectuée à bord d’un navire et immédiatement après un sauvetage.
La mise en place d’obstacles juridiques et administratifs poursuit un objectif évident : éloigner les navires de sauvetage de leurs zones d’opération, limitant ainsi considérablement leur présence et leurs activités en mer. Sans la présence des bateaux et des avions des ONG, davantage de personnes se noieront en tentant de traverser la Méditerranée centrale, et les violations des droits humains ainsi que les naufrages passeront inaperçus. Les petits navires jouent un rôle crucial : ils patrouillent, fournissent les premiers secours aux personnes en détresse à bord des bateaux et, si nécessaire, embarquent les survivant.es jusqu’à l’arrivée de navires mieux équipés.
Depuis février 2023, les navires des ONG ont fait l’objet de 29 détentions, ce qui représente un total de 700 jours passés dans les ports au lieu de sauver des vies en mer. Ils ont passé 822 jours supplémentaires en mer pour rejoindre des ports de débarquement assignés dans des lieux situés à des distances injustifiables, représentant au total 330 000 kilomètres de navigation. Ce qui ne concernait initialement que les navires de recherche et sauvetage civils s’étend désormais aux bateaux de surveillance plus petits.
En outre, les ONG consacrent énormément de temps et de ressources financières à contester la législation restrictive de l’Italie et les détentions administratives qui leur sont arbitrairement imposées.
Au cours des mois précédents, les tribunaux nationaux – à Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia et Ancône – ont rendu des décisions reconnaissant l’illégalité de la détention des navires de sauvetage des ONG dans les ports et ont, par conséquent, annulé les amendes correspondantes. En octobre 2024, le tribunal de Brindisi a demandé à la Cour constitutionnelle italienne d’évaluer la compatibilité du « décret Piantedosi », converti en loi en février 2023, avec la Constitution italienne. Le 8 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que le droit de la mer ne pouvait être contourné par des normes punitives et discriminatoires et que toute décision contraire à celui-ci devait être considérée comme illégale et illégitime.
La non-assistance est un crime !
En vertu du droit maritime international, tout capitaine de navire a l’obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer. De même, tout État qui gère un centre de coordination des opérations de sauvetage est légalement tenu de faciliter et de lancer des opérations de sauvetage sans délai. Or, aujourd’hui, ce à quoi nous assistons n’est pas un échec de l’État, mais un ensemble de violations délibérées : rétention d’informations sur les cas de détresse, coordination avec les soi-disant garde-côtes libyens pour des refoulements illégaux – même dans les eaux maltaises –, tandis que les avions de Frontex observent les naufrages et les interceptions violentes sans intervenir.
Ces pratiques constituent une violation flagrante de la Convention SOLAS, de la Convention SAR, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et du principe de non-refoulement. Lorsque les États entravent les opérations de sauvetage au lieu de les faciliter, ils n’appliquent pas la loi, ils la violent.
Contexte
En décembre 2024, le « décret Flussi » (converti en loi 145/2024) relatif à la législation en matière de migration et d’asile adopté par le gouvernement italien est entré en vigueur. Il renforce les dispositions déjà restrictives du « décret Piantedosi », prévoyant comme sanctions des amendes, la détention et la confiscation définitive des navires de recherche et de sauvetage. Les nouvelles dispositions facilitent la confiscation des navires en rendant les armateurs responsables des violations répétées, quel que soit le capitaine, et constituent donc un levier supplémentaire pour entraver les activités des ONG de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale.
Il y a dix ans, les ONG de recherche et de sauvetage ont commencé à combler le vide mortel laissé par l’UE et ses États membres en Méditerranée centrale. Alors que l’UE se concentre de plus en plus sur le contrôle et l’externalisation des frontières afin d’empêcher toute arrivée sur les côtes européennes, plus de 175 500 personnes ont été secourues par des navires d’ONG depuis 2015. Cependant, depuis 2017, les acteurs SAR sont de plus en plus exposés à la criminalisation et à l’entrave de leurs activités en raison de lois et de politiques restrictives qui contredisent le droit maritime international et les droits humains.
Nous exigeons :
- L’abrogation immédiate des décrets Piantedosi et Flussi, mettant fin aux demandes inhumaines imposant aux navires de sauvetage de procéder à des débarquements partiels et à l’affectation de ports éloignés. Conformément au droit maritime international, les personnes qui viennent d’être secourues doivent être débarquées sans délai dans le lieu sûr le plus proche ; elles ne doivent pas être contraintes d’endurer de longs voyages et être instrumentalisées à des fins politiques.
- La libération immédiate du navire de surveillance Nadir et la fin de la criminalisation et des entraves aux activités SAR non gouvernementales.
- Que les États membres de l’UE remplissent leur devoir de sauvetage en mer et respectent le droit international. Les autorités devraient fournir à tous les navires des ONG le soutien nécessaire à la coordination des opérations de sauvetage afin qu’ils puissent assumer leur responsabilité de secourir les personnes en détresse.
- La mise en place d’un programme de recherche et de sauvetage financé et coordonné par l’UE.
- Des voies d’accès sûres et légales vers l’Europe afin d’empêcher que des personnes soient contraintes de monter à bord d’embarcations précaires et d’entreprendre des voyages périlleux et parfois mortels.
- Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
- borderline-europe, Human rights without borders e.V.
- Captain Support Network
- Cilip | Bürgerrechte & Polizei
- CompassCollective
- CONVENZIONE DEI DIRITTI NEL MEDITERRANEO
- EMERGENCY
- European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
- Gruppo Melitea
- iuventa-crew
- LasciateCIEntrare
- Maldusa project
- Médecins Sans Frontières
- MEDITERRANEA Saving Humans
- MEM.MED Memoria Mediterranea
- migration-control.info project
- MV Louise Michel project
- Open Arms
- RESQSHIP
- r42 Sail And Rescue
- Refugees in Libya
- Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
- SARAH-Seenotrettung
- Sea-Eye
- Sea Punks e.V
- Sea-Watch
- SOS Humanity
- SOS MEDITERRANEE
- Statewatch
- Tunisian Forum for Social and Economic Rights FTDES
- United4Rescue
- Watch the Med Alarm Phone
L’acharnement contre les navires de recherche et de sauvetage cause des centaines de morts en mer
32 organisations exigent que l’Etat italien cesse immédiatement les entraves systématiques opposées aux opérations de recherche et de sauvetage (SAR) menées par des organisations non gouvernementales. Au cours du mois dernier, des navires d’ONG ont été immobilisés à trois reprises en raison de restrictions légales fondées sur des allégations relevant du « décret Piantedosi ». L’un d’entre eux, le navire de surveillance Nadir de l’ONG RESQSHIP, a été immobilisé à deux reprises. Le fait de délibérément tenir à distance les organisations non gouvernementales de recherche et de sauvetage de la Méditerranée centrale entraîne d’innombrables décès en mer sur l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde.
Malgré les nombreuses alertes lancées par les organisations SAR, les navires des ONG continuent d’être arbitrairement immobilisés depuis l’adoption du « décret Piantedosi » en janvier 2023, aggravée par la conversion en loi du « décret Flussi » en décembre 2024. Au cours du mois dernier, les petits navires de RESQSHIP et de Sea-Eye, le Nadir et le Sea-Eye 5, ont été immobilisés, accusés de ne pas avoir respecté les instructions des autorités. Les deux équipages ont reçu des ports très éloignés pour le débarquement des personnes survivantes et ont été invités à procéder à des transbordements partiels de personnes sur la base de critères de vulnérabilité, alors qu’une évaluation fiable de la vulnérabilité nécessite un environnement sûr et ne peut être effectuée à bord d’un navire et immédiatement après un sauvetage.
La mise en place d’obstacles juridiques et administratifs poursuit un objectif évident : éloigner les navires de sauvetage de leurs zones d’opération, limitant ainsi considérablement leur présence et leurs activités en mer. Sans la présence des bateaux et des avions des ONG, davantage de personnes se noieront en tentant de traverser la Méditerranée centrale, et les violations des droits humains ainsi que les naufrages passeront inaperçus. Les petits navires jouent un rôle crucial : ils patrouillent, fournissent les premiers secours aux personnes en détresse à bord des bateaux et, si nécessaire, embarquent les survivant.es jusqu’à l’arrivée de navires mieux équipés.
Depuis février 2023, les navires des ONG ont fait l’objet de 29 détentions, ce qui représente un total de 700 jours passés dans les ports au lieu de sauver des vies en mer. Ils ont passé 822 jours supplémentaires en mer pour rejoindre des ports de débarquement assignés dans des lieux situés à des distances injustifiables, représentant au total 330 000 kilomètres de navigation. Ce qui ne concernait initialement que les navires de recherche et sauvetage civils s’étend désormais aux bateaux de surveillance plus petits.
En outre, les ONG consacrent énormément de temps et de ressources financières à contester la législation restrictive de l’Italie et les détentions administratives qui leur sont arbitrairement imposées.
Au cours des mois précédents, les tribunaux nationaux – à Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia et Ancône – ont rendu des décisions reconnaissant l’illégalité de la détention des navires de sauvetage des ONG dans les ports et ont, par conséquent, annulé les amendes correspondantes. En octobre 2024, le tribunal de Brindisi a demandé à la Cour constitutionnelle italienne d’évaluer la compatibilité du « décret Piantedosi », converti en loi en février 2023, avec la Constitution italienne. Le 8 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que le droit de la mer ne pouvait être contourné par des normes punitives et discriminatoires et que toute décision contraire à celui-ci devait être considérée comme illégale et illégitime.
La non-assistance est un crime !
En vertu du droit maritime international, tout capitaine de navire a l’obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer. De même, tout État qui gère un centre de coordination des opérations de sauvetage est légalement tenu de faciliter et de lancer des opérations de sauvetage sans délai. Or, aujourd’hui, ce à quoi nous assistons n’est pas un échec de l’État, mais un ensemble de violations délibérées : rétention d’informations sur les cas de détresse, coordination avec les soi-disant garde-côtes libyens pour des refoulements illégaux – même dans les eaux maltaises –, tandis que les avions de Frontex observent les naufrages et les interceptions violentes sans intervenir.
Ces pratiques constituent une violation flagrante de la Convention SOLAS, de la Convention SAR, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et du principe de non-refoulement. Lorsque les États entravent les opérations de sauvetage au lieu de les faciliter, ils n’appliquent pas la loi, ils la violent.
Contexte
En décembre 2024, le « décret Flussi » (converti en loi 145/2024) relatif à la législation en matière de migration et d’asile adopté par le gouvernement italien est entré en vigueur. Il renforce les dispositions déjà restrictives du « décret Piantedosi », prévoyant comme sanctions des amendes, la détention et la confiscation définitive des navires de recherche et de sauvetage. Les nouvelles dispositions facilitent la confiscation des navires en rendant les armateurs responsables des violations répétées, quel que soit le capitaine, et constituent donc un levier supplémentaire pour entraver les activités des ONG de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale.
Il y a dix ans, les ONG de recherche et de sauvetage ont commencé à combler le vide mortel laissé par l’UE et ses États membres en Méditerranée centrale. Alors que l’UE se concentre de plus en plus sur le contrôle et l’externalisation des frontières afin d’empêcher toute arrivée sur les côtes européennes, plus de 175 500 personnes ont été secourues par des navires d’ONG depuis 2015. Cependant, depuis 2017, les acteurs SAR sont de plus en plus exposés à la criminalisation et à l’entrave de leurs activités en raison de lois et de politiques restrictives qui contredisent le droit maritime international et les droits humains.
Nous exigeons :
- L’abrogation immédiate des décrets Piantedosi et Flussi, mettant fin aux demandes inhumaines imposant aux navires de sauvetage de procéder à des débarquements partiels et à l’affectation de ports éloignés. Conformément au droit maritime international, les personnes qui viennent d’être secourues doivent être débarquées sans délai dans le lieu sûr le plus proche ; elles ne doivent pas être contraintes d’endurer de longs voyages et être instrumentalisées à des fins politiques.
- La libération immédiate du navire de surveillance Nadir et la fin de la criminalisation et des entraves aux activités SAR non gouvernementales.
- Que les États membres de l’UE remplissent leur devoir de sauvetage en mer et respectent le droit international. Les autorités devraient fournir à tous les navires des ONG le soutien nécessaire à la coordination des opérations de sauvetage afin qu’ils puissent assumer leur responsabilité de secourir les personnes en détresse.
- La mise en place d’un programme de recherche et de sauvetage financé et coordonné par l’UE.
- Des voies d’accès sûres et légales vers l’Europe afin d’empêcher que des personnes soient contraintes de monter à bord d’embarcations précaires et d’entreprendre des voyages périlleux et parfois mortels.
- Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
- borderline-europe, Human rights without borders e.V.
- Captain Support Network
- Cilip | Bürgerrechte & Polizei
- CompassCollective
- CONVENZIONE DEI DIRITTI NEL MEDITERRANEO
- EMERGENCY
- European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
- Gruppo Melitea
- iuventa-crew
- LasciateCIEntrare
- Maldusa project
- Médecins Sans Frontières
- MEDITERRANEA Saving Humans
- MEM.MED Memoria Mediterranea
- migration-control.info project
- MV Louise Michel project
- Open Arms
- RESQSHIP
- r42 Sail And Rescue
- Refugees in Libya
- Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
- SARAH-Seenotrettung
- Sea-Eye
- Sea Punks e.V
- Sea-Watch
- SOS Humanity
- SOS MEDITERRANEE
- Statewatch
- Tunisian Forum for Social and Economic Rights FTDES
- United4Rescue
- Watch the Med Alarm Phone
Suppression of Movement Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
Répression de la mobilité
Contrôle de la migration, précarité fabriquée et régimes frontaliers racialisés dans l’Algérie post-Hirak : au nom de la souveraineté, au service de l’accumulation de rentes
« Aujourd’hui, nous pouvons tout faire, à condition de ne pas imiter l’Europe, à condition de ne pas être obsédés par le désir de rattraper l’Europe. L’Europe vit aujourd’hui à un rythme si fou, si imprudent, qu’elle a perdu tout repère, toute raison, et qu’elle court à toute vitesse vers l’abîme ; nous ferions bien de l’éviter à toute vitesse. »
— Frantz Fanon, 1961
Ces dernières années, les autorités algériennes ont considérablement durci leurs politiques (anti-)migratoires. Les refoulements vers la Tunisie et les expulsions massives vers le Niger se sont multipliés, tandis que l’État expulse de plus en plus de personnes vers la Libye et le Maroc. L’image d’une « nouvelle Algérie » prospère, propagée par le régime post-Hirak, est toutefois largement contredite par le nombre croissant d’Algériens harraga qui préfèrent à nouveau risquer la migration clandestine plutôt que de rester dans le pays.
Dans le passé, l’Algérie, contrairement à ses voisins, était considérée comme extrêmement réticente à s’intégrer officiellement dans le régime frontalier européen, refusant presque systématiquement de participer aux projets de « gestion des frontières » financés par l’Europe. Sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune et du chef d’état-major Said Chengriha, l’État a cependant amorcé un revirement prudent, intensifiant sa coopération (anti-)migratoire avec l’Allemagne, l’Italie, l’OIM et la Ligue arabe, notamment en matière de formation policière et de collaboration en vue d’expulsions.
Les représailles de l’État contre les harraga, la précarité artificielle imposée à des milliers de personnes et le racisme systémique (re)produit par l’État et par une grande partie de la société contrastent fortement avec le passé anti-impérialiste de l’Algérie. Le régime continue d’entretenir une image politique nourrie par l’esprit de l’Algérie postcoloniale des années 1960 et 1970. Pourtant, dans les faits, il ne subsiste que des traces de cet alignement autrefois affirmé avec le Sud global. La solidarité internationale que l’État algérien exprime parfois apparaît aujourd’hui conditionnelle et sélective, motivée par les luttes internes au régime pour l’accès aux rentes des hydrocarbures et, au mieux, par des « stratégies anti-impérialistes » de politique étrangère.
Le contrôle des migrations est devenu un enjeu omniprésent dans les discours publics et les interventions gouvernementales à travers l’Afrique du Nord. Toutefois, la situation algérienne reste largement méconnue. Ce rapport vise donc à contribuer à combler cette lacune en dressant un état des lieux des mesures répressives prises par l’État à l’encontre des harraga algériens et non algériens, des infrastructures de rétention mises en place par les autorités, des pratiques d’expulsion des services de sécurité, ainsi que de l’engagement de l’Algérie auprès de gouvernements étrangers dans la répression des mobilités migratoires. À cet égard, la coopération de l’Algérie avec la Tunisie, la Libye, l’Italie, l’Allemagne, mais aussi avec l’OIM, le HCR, la Ligue arabe et son « organisme scientifique », l’Université arabe Naif pour les sciences de la sécurité (NAUSS) basée à Riyad, revêt une importance particulière.
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Suppression of Movement
Migration Control, Manufactured Precarity and Racialised Border Regimes in Post-Hirak Algeria: In the Name of Sovereignty, at the Service of Rent Accumulation
“We today can do everything, so long as we do not imitate Europe, so long as we are not obsessed by the desire to catch up with Europe. Europe now lives at such a mad, reckless pace that she has shaken off all guidance and all reason, and she is running headlong into the abyss; we would do well to avoid it with all possible speed.”
Frantz Fanon, 1961
In recent years, Algerian authorities have substantially tightened their (anti-)migration policies. Pushbacks to Tunisia and mass expulsions to Niger were expanded while the state is deporting more and more people to Libya and to Morocco. The image of a prosperous ‘New Algeria’, propagated by the post-Hirak regime, is, meanwhile, strongly contradicted by the increasing number of Algerian harraga who are once again favoring the risks of a clandestine migration over remaining in the country.
In the past, Algeria, unlike neighboring countries, was considered extremely reluctant to formally integrate into the European border regime, near-consistently refusing to take part in Europe-funded ‘border management’ projects. Under President Abdelmajid Tebboune and army chief Said Chengriha, however, the state initiated a cautious turnaround and intensified its (anti-)migration cooperation with Germany, Italy, IOM and the Arab League, mostly in regards to police training and deportation cooperation.
The state’s reprisals against the harga, the manufactured precarity of thousands of people and the widespread racism (re-)produced by the state and large parts of society are, however, in stark contrast to Algeria’s anti-imperialist past. The state maintains a political imagery nurtured by the spirit of the post-colonial Algeria of the 1960s and 70s. Yet, de facto, only traces of this once staunch alignment with the Global South remain. The international solidarity occasionally vocalised by the Algerian state is today a conditional and selective one, driven by the regime’s internal tug-of-war over access to the hydrocarbon revenues and, at best, the “anti-imperialist strategies” of foreign policy.
Migration control has turned into an ever-present subject of public discourses and government interventions across northern Africa. Corresponding matters in Algeria, however, remain strongly unreported. Accordingly, this report aims at contributing to bridge this gap by providing a mapping of the state’s crackdowns against Algerian and non-Algerian harraga, the authorities’ retention infrastructure, the security services’ deportation practices, and Algeria’s engagement with foreign governments regarding the suppression of movement. In particular relevant in this regard are Algeria’s cooperation with Tunisia, Libya, Italy, Germany as well as with IOM, UNHCR and the Arab League and its ‘scientific body’, the Riyadh-based Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).
Rapport de l’OST – Avril 2025
Le tempo de la protestation s’accélère à nouveau …entre les revendications syndicales et celles relatives aux droits civiques
Le nombre de protestations a doublé au cours du mois d’avril 2025, exprimant une colère et un mécontentement populaires généralisés. Ce mois a enregistré une augmentation du niveau des revendications liées aux droits économiques et sociaux, ainsi que des revendications liées aux droits de l’homme et au droit à la liberté d’expression et à un procès équitable. Comme prévu par l’Observatoire social tunisien du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le rythme des protestations au cours du mois d’avril a augmenté pour atteindre 422 actions de protestation, par rapport à seulement 217 actions au cours du mois précédent de mars 2025. Le mois d’avril a été dominé par des revendications liées aux droits professionnels et du travail, dont 45% étaient liées au règlement du statut professionnel, au droit au travail, au droit de payer les salaires en retard, à la violation des droits des travailleurs, à l’amélioration des conditions de travail, au licenciement arbitraire, à la mise en œuvre des accords en suspens et à la délimitation des dossiers professionnels « traditionnels » en suspens, tels que le dossier des ouvriers des chantiers de plus de 45 ans, les dossiers des enseignants et des enseignants suppléants, et le dossier des employés des associations qui travaillent avec les personnes handicapées. Parallèlement à ce qui se passe dans le domaine social, la rue tunisienne a connu un retour en force du mouvement civil, politique et des droits de l’homme, qui a représenté 28,44% du nombre total de mouvements observés au cours du mois d’avril 2025. Ce mouvement était principalement lié à des revendications relatives aux développements de l’affaire dite du « complot », où des mouvements ont été organisés pour dénoncer la procédure judiciaire, considérée comme n’ayant pas satisfait aux conditions d’un procès équitable et public, les familles des détenus et les journalistes ayant été empêchés d’assister au procès, de le couvrir et de le suivre. Outre l’arrestation de l’avocat et ancien juge Ahmed Souab, les personnes arrêtées dans l’affaire dite de conspirationont entamé une grève de la faim pour rejeter le procès à distance. Abir Moussi, présidente du parti Destourian libre, a protesté contre le fait qu’on lui refuse l’accès direct à ses enfants le jour de l’Aïd al-Fitr. Le mois d’avril a été marqué par un regain d’activisme et de manifestations réclamant la dépénalisation du travail civil et la libération des personnes arrêtées pour leur travail humanitaire, comme Saadia Mesbah, Cherifa Riahi, Mustafa Jamali, Abdallah Said, Mohamed Jouaou, Iyadh Boussalmi, Abdelrazak Krimi et Salwa Grissa… Au cours de ce même mois, les manifestations et les prises de position se sont poursuivies pour soutenir la cause palestinienne et rejeter l’assaut sur Gaza.
Le décès de trois élèves suite à la chute du mur du lycée à la délégation Mazouna a été le déclencheur d’un état de colère et de mécontentement dont l’impact s’est propagé sur les réseaux sociaux et parmi tous les Tunisiens et Tunisiennes, et a pris des formes régionales qui rappellent les années post-2011. La protestation dans la délé ation de Mazzouna s’est poursuivie pendant des jours et a pris plus d’une forme, de jour comme de nuit, et s’est étendue aux délégations voisines tels que Meknassi, Regab et Menzel Bouzayane. D’une manière générale, il s’agit d’une indication claire de l’absence de justice sociale entre les régions et d’une mise en évidence de la détérioration des établissements d’enseignement dans le secteur public et de l’absence de mesures de protection minimales pour les élèves et le personnel enseignant au sein de ces établissements. Les protestations restent principalement mixtes en termes de perspective de genre des manifestants, puisque le mois a enregistré 20 actions organisées uniquement par des hommes, tandis que le reste des actions ont été organisées conjointement par les deux sexes. Outre les appels à travers les médias et les pétitions, qui ont été un outil d’expression des revendications à environ 56 reprises, les acteurs de la protestation se sont tournés vers l’action sur le terrain dans le reste des manifestations de leurs revendications sociales, économiques, civiles et des droits de l’homme. Les veillées ont représenté la principale forme d’activisme au cours du mois d’avril, soit un tiers des mouvements suivis par l’équipe de l’Observatoire social tunisien, suivies par les grèves, où 54 grèves ont été menées tout au long du mois, puis par les sit-in, où 47 sit-in ont été tenus par des employés et des ouvriers et un sit-in par des pêcheurs. Selon l’échantillon, 27 marches pacifiques, 24 journées de colère et 15 grèves de la faim ont été organisées au cours du mois d’avril. Dans le cadre de leur pression pour obtenir leurs revendications, les acteurs sociaux ont eu recours à l’interdiction des cours, au blocage des routes, à la combustion de pneus en caoutchouc, à la perturbation des activités et au port du badge rouge. Une mobilisation artistique a été adoptée à une occasion. Il est important de noter qu’en avril, les diplômés chômeurs du gouvernorat de Gabès ont marché à pied jusqu’à la présidence de la République pour revendiquer leur droit à l’emploi. Les ouvriers, les employés et les syndicats ont été les principaux acteurs des 157 actions enregistrées en avril 2025. Les travailleurs du secteur médical et paramédical ont constitué le deuxième bloc en termes de protestation. De jeunes médecins, largement soutenus par le personnel médical et paramédical, ont mené une série d’actions pour demander l’amélioration de leurs conditions économiques, le renforcement des institutions de santé publique et leur dotation en équipements nécessaires pour fournir des services médicaux garantissant le droit à la santé de tous les Tunisiens. Les activistes et les défenseurs des droits de l’homme ont organisé 44 actions de protestation, les étudiants ont organisé 30 actions, les prisonniers ont manifesté à 12 reprises, ainsi que les journalistes, les avocats, les chômeurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus régionaux, les commerçants, les athlètes, les ouvriers des chantiers les enseignants et les professeurs. Tout comme au cours des mois précédents, Tunis, la capitale, a connu le plus grand nombre de protestations, avec 84 actions, au cours desquelles les acteurs sociaux se sont rendus à la présidence de la République, soit pour dénoncer les politiques considérées comme un retour à la dictature, à la répression et à l’absence de justice, soit pour exiger son intervention afin d’obtenir la justice sociale et économique tant attendue pour les groupes vulnérables dont les conditions de vie ont été encore plus marginalisées par la détérioration des conditions de vie. De manière inhabituelle, Tozeur a occupé la deuxième place dans le classement des régions les plus protestataires avec 40 actions, suivie de Sidi Bouzid avec 32, Kairouan avec 28, Manouba avec 26 et Gafsa avec 20. Mahdia a connu le plus petit nombre de mouvements sociaux avec 6 protestations, précédée par Zaghouan, Tataouine et l’Ariana, qui ont chacune connu 7 mouvements sociaux. Environ 28 % des mouvements sociaux ont été dirigés vers la Présidence du gouvernement ou la Présidence de la République, tandis que le ministère de l’éducation a été concerné par 15,64 % des mouvements enregistrés au cours du mois d’avril, suivi par le ministère de la santé, qui a provoqué 13 % des protestations. Le ministère de l’agriculture était visé par 6 % des protestations, tandis que le manquement de l’employeur à ses obligations envers les travailleurs et les employés est à l’origine de 9 % des protestations. Les autorités régionales telles que les municipalités, les délégations régionales, les hôpitaux, les autorités judiciaires et les forces de sécurité étaient visés par le reste des protestations. Sur la base de l’échantillon étudié, l’équipe de l’Observatoire social tunisien du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a enregistré 11 cas de suicide et de tentatives de suicide au cours du mois d’avril 2025, dont environ la moitié chez des écoliers âgés de treize à seize ans. Un agent de sécurité s’est suicidé sur son lieu de travail avec sa propre arme, un jeune homme qui a escaladé le poteau électrique devant le tribunal de première instance de Manouba a tenté de se jeter et a menacé de se suicider, un autre dans un mouvement de protestation s’est versé du feu sur le corps au milieu de la foire internationale de Nabeul, et un homme de 50 ans s’est suicidé en se brûlant. La catégorie des suicides se répartit entre 4 femmes et 7 hommes. En ce qui concerne la répartition géographique et spatiale des comportements suicidaires, la majorité des comportements suicidaires et des tentatives de suicide ont été enregistrés dans le gouvernorat de Kairouan qui a connu 5 cas et tentatives de suicide, 2 personnes se sont suicidées à Bizerte, et chacun des gouvernorats de Tunis, Gafsa, Manouba et Nabeul a connu un cas de suicide. Les établissements d’enseignement ont connu 4 cas et tentatives de suicide, tandis qu’un cas de suicide a été enregistré au domicile et un autre sur le lieu de travail, le reste ayant choisi l’espace public (ferme ou voie publique) comme cadre pour mettre fin à leur vie. Les méthodes utilisées pour les tentatives et les cas de suicide varient entre le fait de se jeter, de se pendre, de se brûler, d’absorber des substances toxiques ou des médicaments. La répartition géographique de la catégorie des suicides indique la nécessité de mettre en évidence la question de la prise en charge de la santé mentale des enfants, en tenant compte des répercussions de la fragilité vécue par les jeunes, qui a conduit un certain nombre d’entre eux à mettre fin à leur vie, avec une attention particulière aux conditions de travail d’un certain nombre de professions (les services de sécurité), au sein desquelles le passage à l’acte suicidaire est devenu fréquent. En ce qui concerne la violence, l’Observatoire social tunisien a continué à documenter des actes de meurtre, de violence relationnelle, des cas de violence conjugale, des meurtres de femmes, des agressions sexuelles, des vols, des cambriolages, des trafics, des détournements de mineurs, des enlèvements, souvent à titre de représailles ou à des fins d’agression, et d’intimidation, ce qui confirme que le phénomène de la violence ne peut être limité et qu’il est répandu et inégalement réparti dans les différents gouvernorats de la République, Tunis, la Manouba et Sousse enregistrant le plus grand nombre d’entre eux. Les actes de violence et de marginalisation sont répandus aussi bien dans les grandes agglomérations urbaines que dans les zones rurales. L’espace public est le principal cadre des actes de violence observés au cours du mois d’avril, suivi de l’espace d’habitation, puis des installations de production industrielle, des sièges administratifs, des espaces récréatifs et touristiques, et des espaces de santé. La majorité des auteurs de violence étaient des hommes, représentant 91 % des délinquants. Six pour cent des violences ont été perpétrées par des femmes, le reste étant mixte. En ce qui concerne les victimes de la violence, aucun des deux sexes n’est exclu des cas de violence enregistrés. 44,44 % des victimes de la violence étaient des hommes, 42,22 % des femmes et 13,33 % des hommes et des femmes. Parmi les cas de violence à l’égard des femmes, nous trouvons un mari qui a brûlé sa femme dans le gouvernorat de Tozeur et s’est ensuite enfui en Algérie, et un crime similaire à Sejoumi, où un mari a tué sa femme à l’aide d’un instrument tranchant, et dans la région de Gobaa, dans le gouvernorat de Manouba, un mari a tué sa femme et poignardé sa fille. Dans le gouvernorat de Manouba, le corps d’une avocate a été retrouvé brûlé et jeté dans l’oued Majerda, et dans le gouvernorat de Gabès, une fille a été poignardée par son amie après une dispute entre elles, et les cours ont été suspendus suite à l’agression d’un enseignant dans une école de Manouba par un parent d’élève, et à Kasserine, un groupe de personnes a fait intrusion dans un lieu de mariage, créant un état de panique et d’effroi. Le mois a également enregistré des cas de viols et de tentatives de détournement visant des enfants mineurs, hommes et femmes, et a été témoin de meurtres, de violences mutuelles, de braquages, de vols et de cas de violences policières visant des supporters d’équipes sportives et des citoyens, dont le plus marquant a été l’agression du chauffeur de bus à Nabeul. Les discours de haine, de racisme, d’exclusion et de discrimination continuent à se multiplier sur les réseaux sociaux, et leur cercle s’élargit encore à mesure que des voix rejettent les voies judiciaires, économiques et sociales adoptées par les autorités, tandis que le discours officiel tend à diviser davantage les Tunisiens entre patriotes, antipatriotes, conspirateurs et loyalistes.
Mort dissimulée sur les côtes tunisiennes
الموت المخفي على السواحل التونسية
لفظت شواطئ ولاية صفاقس وولاية المهدية منذ يوم الاحد 8 جوان عشرات الجثث من المحتمل انها تعود لمهاجرين غير نظاميين. في سياق يتم بحجب المعلومات عن الرأي العام الوطني لا تنشر السلطات الرسمية اية معطيات تفصيلية الا نادرا حول حوادث الغرق على طول السواحل التونسية منذ جوان 2024.
تتكرر هذه المآسي في سياق اختارت فيه الدولة طرد المهاجرين من الأماكن التي نقلتهم اليها منذ نهاية 2023 دون تقديم بدائل للإيواء خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تتواصل عمليات الطرد الى الحدود لمن يتم اعتراضهم في البحر بعد مصادرة اية وسيلة اتصال مع العالم الخارجي.
ان مشاهد الموت على السواحل والطرد الى الحدود وحرق وتدمير المخيمات وشهادات الأشخاص المتنقلين واللاجئين تناقض السردية الرسمية حول الدروس الإنسانية في التعامل مع المهاجرين.
ومع ذلك، فإن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى شبكات تهريب المهاجرين وممارسات السلطات التونسية بل هي نتاج انخراط في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وأمننة الهجرة والقبول بدور حائط صدّ للقلعة الأوروبية والتبرير لذلك في الخطاب الرسمي.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يترحم على ارواح الضحايا ويتقدم بتعازيه الحارة لعائلاتهم ويتمنى السلامة للمفقودين.ات ويعبّر عن تضامنه مع كل العائلات في هذا المأساة الإنسانية.
- يعبر عن تضامنه مع كل الأشخاص المحرومين من التنقل والغذاء والدواء المشردين في غابات الزيتون وفي الصحاري وعلى الحدود ويدعو للقطع مع هذه الممارسات غير الإنسانية.
- يدعو للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية.
- يطالب بمزيد الشفافية في ملف الهجرة واعلام الرأي العام الوطني بكل المعطيات حول عمليات منع اجتياز الحدود البحرية وحوادث الغرق وعمليات الترحيل القسري وتفاصيل التعاون مع الطرف الأوروبي.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
Session préparatoire à la Conférence sur les droits et libertés et pour une République démocratique juste Discours du président du FTDES
Séance préparatoire au congrès sur les droits, les libertés et pour une république démocratique équitable
Allocution inaugurale du président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux
- Abderrahman Hedhili
Mesdames et Messieurs,
Chers militant.e.s pour la liberté et la justice de tous bords, je vous salue chaleureusement.
Nous avons réussi à organiser cette session préparatoire en réponse à l’attaque qui a visé nos initiatives dès les premières heures suivant leur annonce. Après quelques jours, cette attaque s’est réorientée vers la Ligue et son président, à qui nous renouvelons notre entière solidarité. Nous ne voyons dans cette attaque qu’un signe de lâche angoisse et de crainte du système au pouvoir face à des initiatives nationales sérieuses qui remettent en cause la tyrannie.
Les jours qui ont suivi la publication de notre initiative ont été difficiles et riches en enseignements intenses, car ils nous ont permis de faire une distinction claire entre ce que nous représentons, nous qui sommes ici aujourd’hui dans cette salle et beaucoup d’autres, en tant que mouvement démocratique et de défense des droits humains qui n’a pas cédé et ne cédera pas aux menaces et aux pressions pour défendre les droits, la liberté et la justice , et ce que représentent ceux qui nous prennent pour cible dans les cercles partisans et médiatiques qui soutiennent la tyrannie, qui restent silencieux face aux violations des droits humains et prônent un régime autocratique. Ils se réjouissent même parfois ouvertement du sort des victimes de l’oppression, se délectant de leurs souffrances. L’importance de cette distinction réside dans le fait de tracer une ligne entre nous, qui croyons en la liberté, les droits et une république démocratique, et ceux qui défendent la tyrannie et justifient son oppression, son despotisme et son échec.
Notre appel à une conférence nationale, tel qu’énoncé dans notre premier appel, est intervenu après que la situation ait atteint son paroxysme et après le procès grotesque connu sous le nom d’affaire de complot et les verdicts injustes qui en ont résulté, puis l’arrestation de l’avocat et juge militant Ahmed Souab, qui a ébranlé le régime autoritaire dans ses fondements et révélé sa véritable nature.
Cependant, cet appel, dans son essence, même s’il intervient aujourd’hui, est l’aboutissement d’un rôle national que nous n’avons pas abandonné au sein du FTDES et de la ligue, ni avant le 25 juillet, ni après. Nous avons mis en garde à plusieurs reprises contre le danger de la dérive du régime vers un pouvoir individuel absolu, clairement incarné par le décret 117, puis par la Constitution de 2022 et le référendum qui a été ratifié et boycotté par la majorité des électeurs, suivi par les élections législatives qui ont été rejetées par la plupart des forces politiques et qui manquaient d’intégrité, de pluralisme et de concurrence entre les programmes. Nous avons contribué à partir d’une position de responsabilité historique et de positions avancées et actives dans l’initiative de dialogue appelée de ses vœux par l’Union générale tunisienne du travail, mais celle-ci n’a jamais vu le jour.
Le déclin, la faiblesse et la fragmentation de la société civile, ainsi que l’absence d’une vision unificatrice et d’une feuille de route claire, ont contribué à l’emprise croissante du pouvoir en place et au resserrement de son contrôle sécuritaire et judiciaire sur la société. La situation ne changera pas tant que l’équation actuelle persistera.
Les élections présidentielles de 2024 ont constitué un revers politique qui nous a ramenés à une époque révolue que la révolution avait cherché à abolir. Ces élections n’ont pas respecté les conditions minimales d’équité et de transparence et se sont soldées par un soutien à 90 % au président sortant, après que celui-ci ait refusé de se livrer à une véritable compétition avec les candidats qui souhaitaient le défier. La commission électorale nommée a refusé d’appliquer la décision du tribunal administratif de réintégrer trois candidats dans la course. De plus, les tribunaux ont pris l’initiative d’écarter le candidat Ayachi Zamal de la compétition en l’emprisonnant et en le privant de sa campagne électorale. Il reste injustement emprisonné à ce jour. À cela s’ajoute la modification de la loi électorale par le parlement loyaliste et le transfert des litiges électoraux à la cour d’appel au lieu du tribunal administratif quelques jours avant le vote, ce qui constitue un dangereux précédent qui démontre le degré de mépris pour les institutions et la loi.
Nous concluons aujourd’hui que tous les indicateurs d’une dérive autoritaire du régime au pouvoir sont réunis. Au cours des années qui ont suivi le 25 juillet, le système judiciaire a été transformé en un outil de répression de toute opposition et de toute voix libre, y compris les politiciens, les militants de la société civile, les journalistes et les syndicalistes, en particulier après la décision de révoquer des juges et d’exercer des pressions par le biais de nominations, et l’échec de la mise en place d’un Conseil supérieur de la magistrature et d’une Cour constitutionnelle élus. Cela a créé un climat étouffant pour les libertés et un état de peur et de prudence qui s’est répandu dans la société civile, les élites et le grand public, entraînant la perte d’indépendance des institutions législatives de l’État et même la perte de prestige des structures gouvernementales.
Les voix libres et audacieuses se sont éteintes au sein du parlement et même dans les médias, que nous avons perdus en tant qu’espace libre après 2011. Ils ont été persécutés et assiégés, que ce soit par le décret 54 ou sous la pression d’instructions et de la censure. Ils ont progressivement perdu leur rôle dans la transmission d’une image honnête de la réalité et dans l’organisation de la circulation d’idées et d’alternatives libres et diverses. Ils ont été dominés par l’incitation, la diabolisation et la superficialité. Certaines plateformes médiatiques se sont transformées en outils de diffusion de discours de trahison, de violence et de haine parmi les Tunisiens.
Aujourd’hui, de nombreux groupes sont de plus en plus convaincus que le système gouvernemental fermé actuel, qui rejette le dialogue et la reconnaissance de la crise, ne peut fournir une feuille de route pour la réconciliation ou une issue à la crise étouffante dans laquelle se trouve le pays et qui pourrait rapidement s’aggraver dans un contexte régional et international tendu auquel notre pays n’est pas préparé.
Bien que nous ne misions plus nos espoirs sur une réforme politique de l’intérieur, nous sommes convaincus que travailler à faire pencher la balance du pouvoir en faveur d’un changement démocratique par des moyens civils et pacifiques est notre seule voie à suivre, et celle que nous devons poursuivre sans hésitation.
Chers ami.e.s,
Les partisans du régime actuel du président Kais Saied continuent de le promouvoir en invoquant sa légitimité en tant que sauveur et libérateur de la nation et protecteur de la souveraineté nationale. Cependant, au vu des faits, nous réalisons aujourd’hui que ces slogans sont vides de sens et que le régime du 25 juillet a détruit la vie politique, rejeté des élections démocratiques équitables et un transfert pacifique du pouvoir, et terni l’image de la Tunisie à l’étranger. Il s’achemine vers l’affaiblissement des fondements de l’État en tant que garant de la stabilité et vers la destruction des acquis de la société civile et politique, qui remontent non seulement à la période postérieure à 2011, mais aussi à plusieurs décennies auparavant. La lutte pour les droits humains, la démocratie, la justice sociale, le syndicalisme, les droits des étudiants et les droits des femmes en Tunisie est authentique et profondément enracinée. Elle ne s’est pas inclinée dans le passé, elle ne s’incline pas dans le présent et elle ne s’inclinera pas à l’avenir. Quiconque lit l’histoire politique de la Tunisie comprend que même les prisons et les chambres de torture ont renforcé, au fil des générations, la ferme conviction que les droits se gagnent, ils ne se donnent pas. Aujourd’hui, nous sommes déterminés à obtenir tous nos droits, quel qu’en soit le prix.
Nous ne voulons rappeler à personne qui nous sommes, ce que nous étions et ce que nous nous sommes promis, à nous-mêmes, à notre conscience, à notre peuple et à nos amis qui sont aujourd’hui emprisonnés ou exilés, ou qui ont été emportés par la mort. Nous dirons simplement que nous sommes tous Ahmed Souab
et que nous sommes tous Cherifa Riahi
et que nous sommes tous Sonia Dahmani
et que nous sommes tous Issam Chebbi…
et nous sommes tous Rachad Tamboura
et tous ceux qui ont été injustement emprisonnés. En fait, nous sommes tous prisonniers, que ce soit dans les prisons du régime ou dans la grande prison qu’est devenu le pays, et nous avons décidé de briser nos chaînes. Nous ne renoncerons pas à la lutte que nous avons gravée de nos propres mains dans le sol de notre patrie et dans la mémoire de notre peuple.
Nous sommes pleinement conscients que la Tunisie traverse une crise globale et sans précédent qui menace de faire dérailler complètement la lutte pour la démocratie et perturbe une économie qui a désespérément besoin de nouvelles politiques permettant d’instaurer la justice sociale. Le gouvernement actuel répond à la crise structurelle complexe de l’économie par des solutions fragmentées, axées sur la propagande, qui ne proposent pas de changements radicaux dans les politiques économiques publiques, mais reflètent plutôt une soumission non déclarée aux diktats des institutions néolibérales mondiales.
Outre les violations des droits et libertés publics et civils, nous disposons désormais d’indicateurs clairs de la gravité de la crise économique et sociale, qui risque de devenir dangereuse :
En ce qui concerne la propagation du travail précaire : les données indiquent que le nombre de travailleurs a atteint 3 511 600, dont 1 630 000 travaillent dans le secteur informel, soit 46,4 %. À cela s’ajoute le recours continu à des mécanismes d’emploi précaire, la promotion de solutions partielles, le non-respect et la non-mise en œuvre des promesses faites par les gouvernements successifs, ainsi que la répression des mouvements qui exigent leur respect. On observe également une indifférence persistante à l’égard des souffrances et des revendications de larges groupes de travailleurs dans ces secteurs, tels que les travailleurs agricoles, les ouvriers des chantiers, les enseignants remplaçants, les chômeurs, les docteurs et autres. Dans ce contexte, nous exprimons notre solidarité avec les représentants du personnel et les dirigeants du centre international pour la promotion des personnes handicapées dans leur lutte et leur grève de la faim pour récupérer leurs droits bafoués. Des ajustements partiels à certaines situations et la suppression du travail sous-traité ne peuvent garantir des conditions de travail et des salaires décents s’ils ne s’inscrivent pas dans une vision de développement intégrée.
En ce qui concerne l’inflation et la détérioration du pouvoir d’achat : alors que l’inflation globale a atteint 5,7 % en février 2025, elle a atteint 7 % pour les denrées alimentaires. Cela porte atteinte au droit à une vie décente, car cela affecte directement la capacité des citoyens à se procurer de la nourriture et à accéder aux services de base, et contribue à l’augmentation des taux de pauvreté. Tout cela s’inscrit dans un contexte où le pays connaît des perturbations répétées dans les importations de biens de base et de produits alimentaires, ce qui exacerbe les souffrances sociales et aggrave les inégalités et les disparités.
En ce qui concerne la propagation de la pauvreté et de la précarité : selon l’ancien ministre des Affaires sociales, environ 4 millions de Tunisiens, soit plus de 33 % de la population, souffrent de précarité en raison d’un manque de revenus ou d’une perte d’emploi causée par la conjoncture économique. Malgré l’existence de programmes de sécurité sociale, de soins médicaux gratuits et de tarifs bas, ces groupes restent marginalisés et sont confrontés à des prix élevés, à des pénuries de denrées alimentaires de base et à la détérioration des secteurs de la santé publique et des transports. Ces groupes ont toujours un besoin urgent de programmes d’intégration sociale et économique qui leur fournissent un travail et un revenu décents.
En ce qui concerne les services sociaux, nous avons constaté que l’État a abandonné son rôle social :
- La détérioration de l’enseignement public s’est accompagnée de l’expansion et de la prospérité de l’enseignement privé, de la généralisation des cours particuliers et de l’augmentation du coût de ces services. À cela s’ajoute l’effondrement des infrastructures, et la tragique catastrophe qui a frappé Mazouna n’était qu’un signe de cette détérioration et de l’abandon de l’État de ses responsabilités.
- La détérioration de la santé publique et le manque croissant d’établissements de santé, d’équipements adéquats, de ressources humaines dans de nombreuses spécialités et de médicaments nécessaires, obligeant les patients à se tourner vers le secteur privé, qui impose des prix exorbitants pour des services médicaux que seuls les riches et la classe moyenne supérieure peuvent se permettre.
- Effondrement du secteur des transports publics : ce secteur souffre d’une négligence chronique, qui a entraîné une réduction des options de transport et un manque d’investissement dans le renouvellement du matériel roulant et l’amélioration des services. Cela s’est traduit, par exemple, par une baisse du nombre de bus dans le Grand Tunis, qui est passé de 1 157 à 350 au cours des dix dernières années, ainsi que par une pénurie de wagons de métro due à l’absence de renouvellement de la flotte depuis plus de 15 ans et à l’impossibilité de les entretenir.
Cela s’ajoute à la criminalisation des mouvements sociaux sous toutes leurs formes et des revendications qu’ils expriment, qui ont longtemps été marginalisés. Les mouvements sociaux ont connu une évolution qualitative, avec près de 2 000 manifestations à la fin du mois de mai 2025. L’État a répondu par la répression et la criminalisation. Les condamnations injustes prononcées à l’encontre de jeunes protestant contre la situation environnementale à Gabès sont une indication claire de la politique de marginalisation et de déni menée par les autorités.
Quant à la question migratoire :
Le discours de février 2023 a marqué le début de nombreuses violations touchant les réfugiés, les demandeurs d’asile, les travailleurs migrants, leurs familles, les étudiants d’Afrique subsaharienne et même les Tunisiens noirs. Un climat de peur s’est installé parmi les migrants, obligeant les pays subsahariens à évacuer leurs ressortissants, tandis que les autres restaient bloqués en Tunisie, pris entre le danger de retourner dans leur pays d’origine et celui de rester en Tunisie dans un climat d’agitation et de mobilisation contre eux. Le discours de haine et de racisme est ainsi passé du discours de groupes dans le cyberespace à une politique d’Etat.
Les autorités tunisiennes ont transformé le pays en une prison ouverte pour les migrants et ont choisi, dans un premier temps, de les expulser dans les oliveraies, privés de tout type de services de base. Puis, dans un deuxième temps, elles ont détruit leurs tentes primitives, les ont dispersés en plein air, les ont traqués sous les arbres et dans les vallées, et les ont expulsés vers les frontières et les déserts. Les femmes et les enfants n’ont pas été épargnés.
Nous affirmons que nous sommes engagés dans nos convictions, en paroles et en actes, pour faire face aux politiques européennes inhumaines dans le domaine de la migration, de l’exportation des frontières au gardiennage par procuration et à la sécurisation de la migration. Nous rejetons les violations qui affectent les droits et la dignité des migrants tunisiens, telles que le racisme, la haine et la déportation forcée, et nous rejetons les mêmes violations qui affectent les migrants en Tunisie.
Nous rejetons également les politiques qui criminalisent la solidarité et stigmatisent la société civile, et nous affirmons notre solidarité avec tous les militants de la société civile détenus. Nous sommes solidaires avec Cherifa Riahi, Saadia Mosbeh, Salwa Ghrissa, Mohamed Joou, Iyadh Bousalmi, Mostafa Jemmali, Abdelrazak Krimi et Abdallah Said.
Dignité pour les migrant.e.s
Liberté pour les détenu.e.s
Ce que nous cherchons aujourd’hui à travers cette conférence et cette séance d’ouverture, ce n’est pas seulement d’élever nos voix de colère, mais aussi de tracer un chemin nécessaire vers un accord national et démocratique qui redonnera l’espoir de sauver l’Etat, de reprendre le processus de transition démocratique et de garantir la citoyenneté et les droits.
Nous savons que ce que la société civile tunisienne a historiquement accumulé, notamment avec l’ouverture de l’espace public au cours des dix dernières années, en termes d’expérience de lutte, de plaidoyer, de mobilisation et de proposition d’alternatives, est menacé mais résiste encore. Nous reconnaissons également que les élites politiques qui ont gouverné et contrôlé l’espace politique ont manqué de nombreuses occasions historiques de rompre avec le passé et d’apporter des changements radicaux aux systèmes politiques, économiques et sociaux en raison des calculs étroits des différentes forces politiques. Les Tunisiens ont également pris conscience que l’objectif des assassinats et des complots terroristes était, à un moment donné, de fragiliser les fondements de l’État-nation et les éléments de la coexistence et de perturber le progrès de la société. Nous ne pouvons pas oublier ou escamoter toute cette phase antérieure avec de faux compromis afin de faire des pas en avant décisifs. Nous devons y revenir pour rendre des comptes, évaluer et critiquer ce qui nous concerne tous, sans exception, afin de reprendre le chemin de la démocratie et de la protéger contre de futurs revers.
Cependant, nous ne considérons pas cette demande légitime et cette étape nécessaire comme un obstacle aujourd’hui aux tâches urgentes que nous proposons pour défendre les libertés et les droits et pour une république démocratique juste.
Les droits auxquels nous croyons sont des droits pour tous, sans discrimination fondée sur l’appartenance, l’idéologie, le sexe, la couleur, le statut social ou le pays. L’État que nous voulons établir n’est pas un État de force qui confisque la société, mais un État de droit fondé sur la justice et la suprématie de la loi, l’égalité de tous devant la loi, la légitimité des institutions, le respect des droits individuels et des libertés publiques, qui ne peuvent être garantis que par une constitution démocratique. Une constitution qui sépare les pouvoirs et rompt avec la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme.
Une république juste est une république qui n’opprime personne, qui ne nie pas les droits des minorités et qui est capable de construire un nouveau contrat social qui rende sa dignité à chacun et réduise les inégalités.
C’est sur cette base que nous organisons cette session préparatoire et que nous nous préparons à organiser une deuxième session générale afin d’atteindre des objectifs clairs :
Premièrement, réunir les conditions de succès suffisantes pour construire un nouvel espace de résistance pour les forces et les dynamiques qui rejettent la tyrannie et recherchent le changement dans le but de rétablir la voie démocratique.
Deuxièmement, lancer une dynamique de terrain et de dialogue entre ceux qui rejettent le régime autocratique et ceux qui veulent le transcender, ce qui implique de faire converger les efforts et de confronter les interprétations et les contributions à la recherche d’un dénominateur démocratique commun sans compromettre la diversité et la différence.
Troisièmement, élaborer une feuille de route politique convenue qui identifie les tâches urgentes et à moyen terme et établit un cadre pour le suivi, l’examen et le développement de leur mise en œuvre.
Quatrièmement, lier les luttes de la société civile et des acteurs politiques aux mouvements sociaux et de protestation afin que la démocratie devienne l’horizon de tous et que la tyrannie ne continue pas à prospérer sur la misère du peuple.
Pour atteindre ces objectifs, nous devons aujourd’hui discuter librement, ouvertement et audacieusement, nous mettre d’accord et nous engager ensemble, car nous n’avons pas d’autre choix que de nous unir contre un seul adversaire : le système actuel au pouvoir.