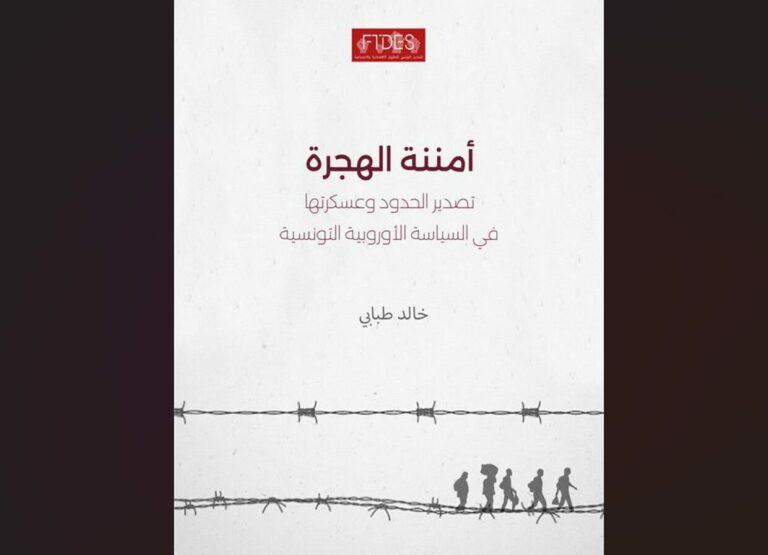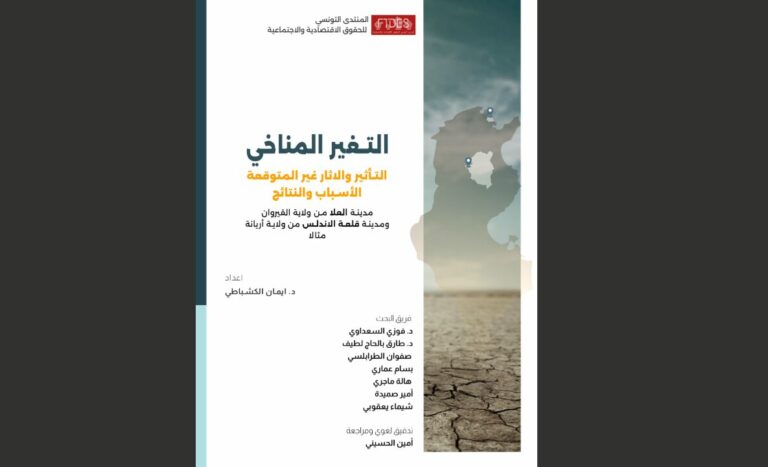NON A LA CRIMINALISATION DE LA SOLIDARITE
Vers une Europe forteresse? Les dangers liés à l’externalisation et l’aspect informel du régime de contrôle des frontières européennes.
Mycea Thebaudeau
Les dangers liés à l’externalisation du régime de contrôle des frontières européennes.
Face à l’intensification des enjeux humanitaires, politiques et juridiques liés aux dynamiques migratoires en Méditerranée, l’Union européenne a proposé en 2020 un nouveau Pacte sur la migration et l’asile. Ce plan européen s’inscrit dans une tendance croissante à l’externalisation du régime de contrôle des frontières européennes. Cette dynamique soulève des questions importantes en matière de solidarité entre les États, et de respect des droits fondamentaux des migrant.e.s et des réfugié.e.s. En quoi consiste la nouvelle politique migratoire européenne et le phénomène d’externalisation des frontières qui l’accompagne? Quels sont les dangers associés à cette externalisation? De plus quel est le rôle de la Tunisie dans ce schéma migratoire? Quelles sont les perspectives qui s’offrent en matière de gestion solidaire de la migration informelle?
La nouvelle politique migratoire européenne
En septembre 2020, la Commission européenne a présenté le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile1. Approuvé par le Parlement européen en avril 2024 puis par le Conseil européen en mai de la même année, ce pacte est supposé entrer en application à partir de 20262. Cette initiative découle notamment de l’inefficacité des précédentes politiques, qui n’ont pas su faire face à la crise migratoire de 2015-2016. La situation ne s’est malheureusement pas améliorée depuis : on compte plus de 40 000 personnes décédées, ou disparues en mer, depuis 20143.
Pour faire face à l’aggravation des impératifs migratoires et humanitaires, ce pacte ambitionne de renforcer la lutte contre l’immigration illégale en accélérant la reconduction des personnes en situation irrégulière, et de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de filtrage aux frontières de l’Union européenne. Cette procédure sera implantée au moyen de « centres de rétention » aux frontières extérieures de l’Union. La mise en place de ces centres, qui compteront « un minimum de 30 000 places au total pour l’ensemble de l’UE », pousse à se demander dans quelles conditions les migrant.e.s et réfugié.e.s seront détenu.e.s, et à quel point le respect de leurs droits fondamentaux peut être garanti4.
Le Pacte se propose également de renforcer la solidarité et la collaboration entre les États membres pour éviter la concentration des demandes dans certains d’entre eux5. C’est particulièrement ce qu’on reprochait au Règlement de Dublin, qui régissait l’accueil des migrant.e.s depuis 1990, et qui stipulait que les demandes d’asiles devaient être traitées par le gouvernement du pays d’entrée sur le territoire européen, ce qui a entraîné un impact démesuré sur les pays d’entrée principaux des routes migratoires vers l’Europe, dont l’Italie, la Grèce, l’Espagne ou encore Malte6.
Vers une Europe forteresse
Cette nouvelle politique migratoire s’inscrit dans une tendance marquée depuis les années 1980 par « une politisation et une sécurisation des questions migratoires et d’asile en Europe »7, qui se traduit par une volonté croissante d’externalisation des frontières européennes. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais s’est considérablement intensifié depuis la crise migratoire de 20158.
L’externalisation, dans son sens premier issu des sciences économiques, signifie « pousser une activité en dehors de son établissement, pour la confier à un sous-traitant contre rémunération »9. Dans le cas de la politique migratoire européenne, dont elle est devenue « l’un des principaux piliers », l’externalisation s’entend comme « le transfert d’activités auprès d’un pays tiers ou d’un acteur non-étatique »10.
Cette stratégie s’appuie sur deux dimensions essentielles. D’abord, sur un plan plus préventif, la première prend la forme d’une aide au développement allouée à des pays tiers, plus précisément les pays de départ des vagues migratoires vers l’Europe, où sévissent des crises politiques, sociales ou économiques. Cette aide a pour but de « lutter contre les causes profondes forçant les personnes à émigrer »11, mais elle présente le risque d’être instrumentalisée, en utilisant pour « répondre aux objectifs sécuritaires des États membres » de l’Union européenne les fonds destinés à « traiter les causes profondes et structurelles de migration »12.
La seconde, plus réactive, se traduit par la signature d’accords de coopération et de traités avec les pays tiers, qu’ils soient les pays par lesquels transitent les migrants et les réfugiés, ou leurs pays d’origine13. Cette approche vise à « endiguer les flux avant leur entrée sur le territoire de l’Union »14. On peut par exemple citer les accords de réadmission, tel que celui signé avec la Turquie en 2016 ou avec la Tunisie en 202315 qui prétendent « faciliter le retour des personnes en séjour irrégulier dans leur pays d’origine ou de transit »16.
Des pratiques contestées, voire condamnables
Selon Théo Buratti, cette « délégation de la gestion des flux migratoires aux pays tiers » peut entraîner des conséquences dangereuses. D’abord, sur le plan du respect du droit international et de la préséance donnée à la démocratie. En effet, en voulant à tout prix partager le fardeau migratoire, l’Europe est portée à fermer les yeux sur les tendances autoritaires, ou carrément les violations des droits humains, dans les pays avec lesquels elle a établi des partenariats17. Un exemple douloureusement illustratif est celui de la Libye, qui n’ayant pas signé la Convention de Genève de 1951, ne garantit aucun droits aux migrant.e.s et aux réfugié.e.s, lesquels sont considérés comme criminels, et même vendus comme esclaves, selon de nombreuses organisations internationales, ce qui est une conséquence dramatique, bien qu’indirecte, de l’externalisation des frontières européennes18.
Un autre problème lié à cette politique est la modification du rapport de force entre l’Union européenne et les pays d’origine ou de transit des migrant.e.s et des réfugié.e.s. En effet, ces derniers sont de plus en plus « utilisés stratégiquement par les pays tiers comme moyen de chantage dans les processus de négociation avec l’UE »19, sans égard pour leurs droits, leur sécurité, voire même leur condition d’êtres humains. Ce type de pressions est particulièrement efficace dans le contexte de la sécuritisation de la question migratoire et de la montée de l’extrême-droite et de la xénophobie en Europe. La « sécuritisation » implique de présenter un enjeu ou encore un groupe comme une menace à la sécurité nationale ou publique, impactant du même coup l’opinion publique à son sujet. La perception de l’enjeu comme une menace immédiate et sérieuse est renforcée par un processus discursif, notamment dans les médias, jusqu’à « mettre en péril la survie physique et morale de l’entité sécuritisée »20.
Les partis d’extrême-droite exploitent la peur suscitée par cette sécuritisation de la question migratoire, allant jusqu’à la mettre en lien avec une montée de l’insécurité et du terrorisme21. Ce type de discours, et leur traction croissante au sein des institutions européennes, influencent de plus en plus les politiques sécuritaires et migratoires des gouvernements du continent.
Frontex, l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, soulève d’autres questionnements. Agissant comme le « bras armé »22 de la politique migratoire européenne, Frontex assure le contrôle aux frontières extérieures de l’Union européenne, ainsi que des tâches liées à la sécurité maritime, aux contrôles de sécurité et aux activités de recherche et de sauvetage23 . Depuis sa fondation en 2004, cette agence connaît un renforcement continu. De plus, elle dispose désormais « d’une capacité d’intervention en cas de défaillance du “contrôle aux frontières extérieures”, même lorsqu’un État ne la sollicite pas »24. Frontex n’ayant « toujours pas nommé de poste de référent au respect des droits humains25», on doit s’interroger sur le risque de dérives relatives aux conditions des migrant.e.s et réfugié.e.s, et au respect de leurs droits fondamentaux lors des opérations.
Quel rôle pour la Tunisie?
Le partenariat conclu entre la Tunisie et l’Union européenne en 2023 peut se résumer à une externalisation de la surveillance des frontières européennes sur le territoire tunisien, en échange d’une coopération européenne avec le régime tunisien, et une reconnaissance de ce même régime26. Cet accord, largement sécuritaire, s’insère précisément dans la ligne préconisée par Georgia Meloni, porte-parole officieuse de l’extrême-droite européenne, qui tente, « moyennant des soutiens financiers », de donner à la Tunisie « le rôle de poste de surveillance avancé pour empêcher que des clandestins n’entrent en Europe par le sud de l’Italie »27, en misant sur la surveillance, le contrôle et le fichage des migrant.e.s28.
Sur le plan financier, la Tunisie se verra accorder une aide de 105 millions d’euros, spécifiquement destinée à la lutte contre l’immigration irrégulière, ainsi qu’une aide budgétaire dite « directe », de 150 millions d’euros, qui tombe très bien dans la mesure où la Tunisie est aux prises avec une grave crise budgétaire, et fait face à des pénuries massives touchant les produits de première nécessité29.
Ce type de pratique est tout à fait cohérent avec la dynamique plus large d’externalisation croissante du contrôle des frontières européennes, et avec l’approche adoptée par l’État tunisien en regard à la migration informelle. Mettant en avant le thème de la sécurité nationale, le gouvernement tunisien conçoit l’immigration informelle comme une menace à l’ordre public et à la sécurité nationale, une perception que vient renforcer une rhétorique populiste qui corrèle le phénomène migratoire avec une augmentation des risques de radicalisation et de criminalité30. Ce type de rhétorique vient appuyer les pratiques répressives de l’État tunisien envers les migrants et réfugiés irréguliers, éclipsant les réalités complexes des mouvements migratoires, et leurs causes structurelles. Faire face aux enjeux migratoires nécessiterait avant tout des politiques économiques et sociales, plutôt que de se rabattre sur une logique répressive et sécuritaire31, qui donne lieu à des « politiques racistes et discriminatoires », entraînant « une forme d’apartheid »32, encore renforcée par la militarisation des contrôles aux frontières terrestres et maritimes ou par l’incarcération des migrants et réfugiés dans des centres de rétention européens.
Les critiques de cet accord ne manquent pas. Un ancien bénévole de médecins du monde, considère qu’il est « absurde de mettre la Tunisie dans cette position intenable et indigne, et de la rémunérer pour adopter une position contraire aux droits humains »33. En effet, le traitement des migrant.e.s et réfugié.e.s par les autorités tunisiennes, malgré ce qu’en dit le président, est inhumain : « des centaines de migrants ont été arrêtés en Tunisie, puis « déportés », selon les ONG, vers des zones inhospitalières sur les frontières avec Algérie et Libye »34. Un autre cas où l’Europe préfère fermer les yeux sur des violations des droits humains en échange de la gestion externe de ses enjeux de migration et d’asile.
Quelles perspectives?
Selon Damien Carême, « s’obstiner à durcir des politiques inefficaces et cruelles est au mieux inutile, au pire contraire à nos valeurs, aux droits européen et international »35. S’attaquer aux causes profondes des migrations, au moyen de plans clairs et complets d’aide au développement par exemple, plutôt que de mettre en œuvre des solutions à court terme comme déléguer le fardeau à des États tiers, est la seule manière efficace de « mettre en place les réponses adaptées, concrètes et nécessaires, aussi bien pour l’Union européenne que pour la sécurité des migrants forcés »36.
Selon Soufiane Jaballah, il est « impératifs de s’appuyer sur des études scientifiques » pour découvrir les causes et les processus individuels qui sont à l’origine des phénomènes migratoires, pour par la suite « transformer ces connaissances en politiques concrètes », plutôt que de tomber dans les préjugés sur les migrants et les réfugiés, ou de suivre les intérêts des institutions et régimes politiques, qu’il s’agisse de l’Union européenne ou de la Tunisie37.
Il importe d’éviter de tomber dans le piège de la sécuritisation de la question migratoire, qui favorise surtout la montée de l’extrême-droite et la discrimination envers les migrants forcés, allant parfois jusqu’à mettre en péril leur sécurité, comme c’est le cas en Tunisie ou en Libye.
Les questions relatives aux enjeux de migration et d’asile en Europe n’appellent pas une réponse simple, mais une réponse concertée, responsable, et mise en œuvre dans le respect du droit international et des droits humains, tout en gardant comme valeur phare la solidarité avec les migrant.e.s et les réfugié.e.s.
—-
Notes et références
1. Vincent Lequeux, le 10 avril 2024. Asile et migrations : la politique européenne en 3 minutes. Toute l’Europe.
2. Barthélémy Gaillard, le 30 mai 2024. Qu’est-ce que le Pacte européen sur la migration et l’asile? Toute l’Europe.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Théo Burrati, 2020. EXTERNALISATION DES FRONTIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE : Enjeux et perspectives. Pour la solidarité : european think and do thank. p.4
8. Ibid., p.8
9. Ibid., p.5
10. Ibid., p.3
11. Ibid., p.5
12. Ibid., p.15
13. Ibid., p.7
14. Ibid., p.5
15. Ibid.
16. Vincent Lequeux, Asile et migrations : la politique européenne en 3 minutes.
17. Théo Burrati, EXTERNALISATION DES FRONTIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE. : Enjeux et perspectives. Pour la solidarité : european think and do thank. p.13
18. Ibid., p.11
19. Ibid., p.14
20. Soufiane Jaballah, 2023. EU-Tunisian Policy of Managing Migration Across the Mediterranean: Addressing Regular and Irregular Flows. Arab Reform Initiative. (toutes les traductions sont libres)
21. Soufiane Jaballah, 2024. De la rue à la mer : Les nouvelles politiques de l’informel en Tunisie. FTDES, p. 19
22. Théo Burrati, EXTERNALISATION DES FRONTIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE, p.16, p. 5
23. Gaillard, Qu’est-ce que le Pacte européen sur la migration et l’asile?
24 Ibid.
25 Ibid.
26. Ibid., p. 27
27. Ibid.
28. Frida Dahmani, 19 juillet 2023. « En faisant de la Tunisie un poste-frontière, l’UE crée un précédent ». Jeune Afrique.
29. Collaboration Jeune Afrique, 17 juillet 2023. Immigration : l’UE et la Tunisie trouvent un accord à 105 millions d’euros. Jeune Afrique.
30. Jaballah, 2024. De la rue à la mer, p. 12
31. Ibid., p. 12
32. Jaballah, 2023. EU-Tunisian Policy of Managing Migration Across the Mediterranean
33. Dahmani, Que veut vraiment faire l’Union européenne en Tunisie ?
34. Collaboration Jeune Afrique, Immigration : l’UE et la Tunisie trouvent un accord à 105 millions d’euros.
35. Tribune, le 5 avril 2024. [Pour / Contre] Le Pacte asile et migration : une solution pour l’Union européenne?. Toute l’Europe.
36. Burrati, EXTERNALISATION DES FRONTIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE, p.15
37. Jaballah, 2024. De la rue à la mer, p. 71
La Tunisie n’est pas un lieu sûr pour les personnes sauvées en mer
- Appeler les autorités tunisiennes à mettre fin aux violations des droits humain à l’encontre des réfugié.es, des demandeur.euses d’asile et des migrant.es, notamment en ce qui concerne les expulsions collectives illégales qui mettent en danger la vie des personnes concernées .
- Appeler les autorités tunisiennes à mettre fin à la répression de la société civile .
- Veiller à ce que les ONG de recherche et de sauvetage et les navires commerciaux n’aient pas pour instruction de débarquer les personnes auxquelles ils portent secours en mer en Tunisie, compte tenu des risques de violations des droits humains dans ce pays et du fait qu’il est impossible de procéder à une évaluation individuelle équitable de ces risques en mer. La Tunisie ne peut être considérée comme un lieu sûr pour les personnes secourues en mer en vertu du droit international applicable .
- Mettre fin au soutien financier et technique apporté aux autorités tunisiennes responsables de graves violations des droits humains dans le cadre du contrôle des frontières et des migrations.