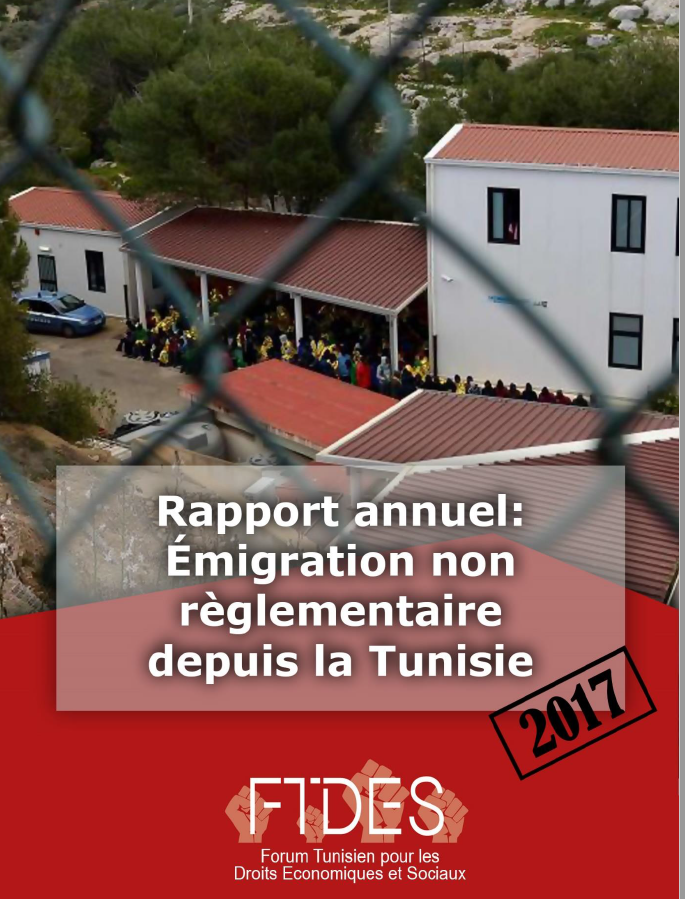Karker : délocalisation des pollutions italiennes au mépris du droit
Karker : délocalisation des pollutions italiennes au mépris du droit
A Kerker, dans le gouvernorat de Mahdia, s’est installée depuis 2012 une usine italienne de production d’huile de grignons d’olive[1], au mépris du droit tunisien et des droits des habitants. Alors qu’elle a été fermée en 2016, elle viendrait d’obtenir une autorisation ministérielle provisoire, bien que la mise aux normes ne soit pas avérée. Les habitants, mobilisés depuis le début du projet et ayant subi les conséquences environnementales et sanitaires pendant les 2 ans de fonctionnement de l’usine, sont toujours inquiets et se remobilisent.
L’usine et ses conséquences
L’usine est détenue par la compagnie Agrind Tunisina, société italienne « totalement exportatrice ». Cela signifie qu’elle bénéficie du régime offshore, en n’ayant pas l’obligation de rapatrier ses bénéfices et en ne payant que 10% d’impôts sur les sociétés contre 25% normalement.
Si elle s’est implantée dans le gouvernorat de Mahdia, c’est aussi pour profiter d’une main d’œuvre moins chère et de normes environnementales moins appliquées qu’en Italie. Maitre Ben Rejeb, avocat des habitants, demande : “comment se fait-il que cette usine soit considérée comme dangereuse en Italie, mais pas en Tunisie ?” L’activité d’extraction d’huile de grignons pollue en elle-même l’air et l’eau des alentours, mais à Kerker, l’installation de l’usine s’est en plus faite sans aucune disposition pour limiter la pollution.
Le procédé d’extraction d’huile requiert une quantité importante d’eau, qui est pompée directement dans la nappe phréatique. Puis pour récupérer l’huile de grignon, il faut ajouter un solvant chimique. C’est l’hexane qui est utilisé à Kerker : il se retrouve ensuite dans les eaux usées qui sont rejetées directement dans un bassin ouvert, aux abords de l’usine, ainsi que dans les fumées et les déchets solides qui sont laissés sur place. Or l’exposition à l’hexane provoque des irritations aux yeux et aux poumons, et, lors d’expositions répétées, il provoque une perturbation du système nerveux et des troubles moteurs[2]. Il est également destructeur pour les écosystèmes aquatiques mais aucun système d’assainissement n’a été prévu, et aucune discussion avec l’ONAS (Office National d’Assainissement) n’aurait été ouverte .

D’autre part, l’extraction d’huile provoque également des fumées et des déchets solides, qui se répandent dans les habitations environnantes
 Les installations de l’usine n’étant pas étanches, la pollution se diffuse tout autour de l’usine et tue toute possibilité d’agriculture. Comme peut en témoigner un agriculteur qui habite juste à côté de l’usine : “Pendant le fonctionnement de l’usine, je ne pouvais plus exploiter les oliviers qui se trouvaient juste derrière elle. On voit encore certains arbres morts. Depuis que l’usine s’est arrêtée, certains ont pu reprendre, mais je ne peux toujours pas utiliser l’eau de la nappe.” Et si deux ans après l’arrêt de l’usine certains arbres ont pu revivre, des champs sont restés à l’abandon depuis (photo arbre noir).
Les installations de l’usine n’étant pas étanches, la pollution se diffuse tout autour de l’usine et tue toute possibilité d’agriculture. Comme peut en témoigner un agriculteur qui habite juste à côté de l’usine : “Pendant le fonctionnement de l’usine, je ne pouvais plus exploiter les oliviers qui se trouvaient juste derrière elle. On voit encore certains arbres morts. Depuis que l’usine s’est arrêtée, certains ont pu reprendre, mais je ne peux toujours pas utiliser l’eau de la nappe.” Et si deux ans après l’arrêt de l’usine certains arbres ont pu revivre, des champs sont restés à l’abandon depuis (photo arbre noir).

Une installation sans respect des lois et des normes environnementales
Ainsi cette entreprise italienne s’est installée sans respecter le droit des habitants à un environnement sain. Les normes environnementales ne sont pas respectées, alors que cela avait été pointé du doigt depuis l’ouverture de l’usine en 2014 par l’Agence Nationale pour la Protection de l’Environnement (ANPE). Ainsi en juillet 2017, l’ANPE rappelle non moins de 9 conditions pour que l’usine puisse reprendre son activité, et notamment la création d’une station d’épuration industrielle, des mesures de restriction de la pollution et l’isolation des déchets.
(Fichier Municipalité 14-oct.-2017 16-55-56, pp. 3-4). Des conditions qui ne sont toujours pas remplies selon l’avocat des habitants. Mais en plus, l’entreprise n’a pas respecté le droit foncier. Elle s’est installée trop proche d’une piste agricole et de la route, en construisant son enceinte autour des poteaux électriques.
Au-delà des lois, les habitants sont extrêmement critiques de la manière dont est gérée l’usine. Comme le montre Mohammed : “Le mur d’enceinte n’est absolument pas étanche, on voit encore les infiltrations, deux ans après ! Le matériel est déjà dégradé, il est de mauvaise qualité et a été importé directement d’Italie. Enfin, 50m3 d’eau sont pompés puis directement rejetés après rajout d’hexane, chaque jour de fonctionnement.”
De plus, la municipalité de Kerker, ainsi que les 400 habitants des alentours, s’opposent au projet. Ces 400 citoyens ont signé une pétition contre l’installation de l’usine, qu’ils ont transmis aux autorités locales et judiciaires dès fin 2014, ce qui a permis de les alerter sur la situation et de faire pression pour qu’elles agissent. Un accord avait finalement été signé entre l’association « Mes compétences » qui représente les citoyens, la municipalité et l’usine, et prévoyait un arrêt de la pollution. Cependant selon les habitants cet accord n’a pas été respecté et l’activité de l’usine a continué de manière inchangée.
Les habitants ont donc poursuivi les procédures, et un huissier a constaté les problèmes posés par l’usine, puis a envoyé son rapport à la municipalité, au gouvernorat, et au Ministère de l’Industrie. D’autre part, suite à des suspicions de corruption, l’association a déposé une plainte auprès du 1er ministre, de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption et de la direction de la Douane nationale et régionales (Sousse et Mahdia). Les conséquences néfastes de l’activité de l’usine ont été reconnues par la justice. Un habitant a notamment reçu 30 000 dinars d’indemnités pour la destruction de ses oliviers, suite à une plainte individuelle.
L’action des habitants a permis de mobiliser les autorités, qui malgré les problèmes constatés dès 2014 par l’ANPE n’avait pas agi en conséquence. Finalement le Ministère de l’Industrie a ordonné l’arrêt de l’usine suite à une mission sur place, conjointe avec l’ANPE en 2016. Cependant, les problèmes ont tout de même perduré. Le matériel et les déchets ont été laissés sur place, et ont continué de se diffuser dans les alentours, toujours sans aucune mesure de protection.
Remise en service prochaine de l’usine
Aujourd’hui, l’usine se prépare à se remettre en activité. Elle aurait obtenu en décembre dernier un permis provisoire de 6 mois, directement de la part du Ministre de l’Industrie. Cependant, cette autorisation poursuit la politique d’impunité et de non-respect du droit : ni le traitement des eaux usées ni des mesures de réduction de la pollution n’ont été effectuées, et le cahier des charges du Ministère de l’Industrie n’est toujours pas respecté selon Maitre Ben Rejeb. On assiste donc même à une contradiction entre la direction du Ministère et ses services ! De plus, la validité de l’autorisation elle-même est contestée par les habitants. En effet, une autorisation ne saurait être provisoire dans ce genre de cas. Elle se doit d’être définitive, après respect du cahier des charges du Ministère de l’Industrie et vérification que les conditions demandées par l’ANPE sont remplies, autorisation de la part des ministères de l’Industrie et de l’Environnement, et approbation de la municipalité. Cette dernière a indiqué en octobre dernier que le dossier était rouvert, mais sans donner son autorisation.
Les inquiétudes sont donc grandes pour la survie des habitants, mais aussi pour la sécurité des travailleurs de l’usine. En effet, on a compté jusqu’à 4 accidents du travail lorsqu’elle était en activité. Les employés auraient été sous-payés, et n’auraient pas bénéficié de la sécurité sociale.
Un révélateur de l’impunité des entreprises étrangères
Cette affaire est révélatrice de l’impunité dont peuvent faire preuve les entreprises étrangères qui s’installent en Tunisie. Alors qu’elles bénéficient déjà d’avantages fiscaux sous le régime offshore, elles délocalisent leurs activités car elles ne respectent plus les normes environnementales dans leurs pays et veulent profiter de bas salaires. Ce faisant, elles ne comptent absolument pas respecter les droits des habitants à un environnement sain, mettant en danger leurs moyens d’existence et leur santé.
De plus, ce cas montre l’attitude passive des autorités. Malgré les constats très alarmants de l’ANPE, qui prévenait du non-respect des normes et des dangers pour la santé des habitants, pour l’agriculture et pour l’environnement, rien n’a été fait pour obliger l’entreprise à appliquer immédiatement le droit. Il a fallu la mobilisation répétée des habitants, et de multiples procédures, pour que les autorités fassent leur travail. Par ailleurs, lorsque l’émission Hannibal a effectué un reportage en 2016 sur le problème, les ministères de l’environnement et de l’industrie ont refusé toute interview. A cause de cette inaction, les habitants ont donc subi les conséquences sur leur santé et leurs revenus agricoles, pendant deux années entières.
Aujourd’hui, alors que le gouvernement tunisien négocie avec l’Union Européenne un nouvel accord de libre-échange, l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi), ce genre de problème pourrait tendre à se multiplier. En effet, cet accord permettrait plus de liberté d’installation aux entreprises étrangères, qui viendraient profiter d’une moins bonne application des réglementations environnementales pour s’implanter en Tunisie, au détriment du bien-être des travailleurs, de la santé des tunisiens, de l’agriculture et de l’environnement.
[1] Les grignons sont des résidus solides obtenus lors du pressage des olives. C’est donc un déchet, qui peut être à son tour transformé en huile de moindre qualité.
[2] http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113§ion=pathologieToxicologie#tab_toxiHomme
Rapport annuel Émigration non règlementaire depuis la Tunisie 2017
Le feu comme symbole du désespoir de la jeunesse Dès le début de l’année 2017, la Tunisie a été marquée par une croissance du nombre de mouvements sociaux qu’ils soient collectifs (sit-in et manifestations d’après l’Observatoire Social Tunisien), ou individuels avec comme expression la plus emblématique : l’immolation, acte historiquement chargé de sens pour la Tunisie. En parallèle, mais surtout à partir du mois de juin 2017, ce rapport démontre une nette augmentation des départs de jeunes Tunisiens de leurs pays par la mer. Et ce à défaut de pouvoir le quitter par la terre ou par les aires, notamment depuis l’augmentation des restrictions d’attribution des visas Schengen pour se rendre en Europe.
Plus communément appelés haragas – brûleurs de frontières, de papiers d ’identité, voire de leurs vies ces jeunes font le choix de risquer la noyade en mer aspirant aux mêmes quêtes d’un avenir meilleur et d’aventures tout comme une grande majorité des jeunes de leur génération, originaires d’autres pays à travers le monde Une ample partie des biens symboliques, comme les clips vidéos globalisés largement consommés par cette tranche d’âge, attise de plus ces envies de voyages, de réussites individuelles et de confort matériel en en faisant la promotion par leurs images. Qui plus est, grâce à internet ces biens symboliques traversent les frontières, eux, sans restriction.
Dans une situation où ni le système scolaire ni l’exode rural ne fonctionnent plus comme leviers de promotion social, ces images viennent alors nourrir les imaginaires de rêves d’ailleurs qui contrastent avec la combinaison de la morosité, de l’augmentation des prix et d’une austérité galopante, caractérisant en ce moment la conjoncture économique tunisienne. Les mobilisations collectives nocturnes de jeunes, ayant parfois incendié des bâtiments publics comme des établissements scolaires en amont du septième anniversaire de la « Révolution de la dignité» début janvier 2018, n’est qu’un exemple de plus que ces désillusions et désespoirs de la jeunesse s’expriment en partie par les flammes. Cette convergence de l’usage du feu comme expression de sa frustration et de sa colère par les jeunes lors de mouvements collectifs n’est pas anodine.
Abstract
Rapport
Abstract (Arabe)
Rapport annuel des mouvements sociaux 2016-2017
OST: Rapport février 2018 des mouvements sociaux
Rapport de l’Observatoire Social Tunisien
Février 2018
Le début du mois de février s’est déroulé dans le prolongement du mois de janvier en termes de recul des protestations, et dont les raisons ont été évoquées dans notre dernier rapport.
Alors que les affaires commençaient à aller dans le sens des attentes du pouvoir, un nouveau problème surgit et redistribue les cartes. La Tunisie a été explicitement classée par les instances économiques européennes en tant que plateforme de blanchiment d’argent voire en tant qu’Etat finançant le terrorisme.
A un moment où nous faisons face à de nombreux problèmes économiques et financiers, les différentes franges sociales s’élèvent contre l’inflation des prix à la consommation et la baisse importante de la valeur internationale de la monnaie tunisienne, tout en recevant les félicitations concernant les réalisations entreprises par le corps sécuritaire pour lutter contre le terrorisme en dépit de quelques imperfections limitées dans certaines régions montagneuses ; à un moment de début de la reprise dans le secteur du tourisme ; à un moment d’ouverture aux investisseurs étrangers ; à ce moment précis, nous apprenons que nous parrainons le terrorisme alors que nous le combattons et que nous sommes une plateforme de blanchiment d’argent alors que nous luttons contre la contrebande, le commerce parallèle et que nous résistons face au commerce transfrontalier. La scène est très floue et a provoqué une variété de réactions et de messages qui nécessitent un sérieux suivi.
Cette annonce de classement a été suivie immédiatement du renvoi du gouverneur de la Banque Centrale ainsi que l’arrestation de plusieurs hauts fonctionnaires de ce même organisme.
Français
ArabeOST: Rapport Janvier 2018
Rapport de l’Observatoire Social Tunisien
Janvier 2018
Le mois de Janvier a connu des débuts difficiles puisque quelques jours seulement après avoir célébré la nouvelle année administrative, des protestations ont éclaté dans tous les gouvernorats. Le fait nouveau et important cette fois-ci est que les manifestations ont été initiées par le mouvement « fech Nestanaou », campagne qui a, semble-t-il, organisé ses mouvements de manière nocturne essentiellement dans l’avenue Habib Bourguiba et avoisinantes.
La nouvelle méthode peut être une révélation du mouvement de protestation que connait l’Iran durant la récente période, qui reposait principalement sur des manifestations de nuit. Si des raisons objectives justifient cette approche dans plusieurs villes iraniennes en raison de la situation sécuritaire, la réalité des libertés ainsi que l’acte protestataire, il semble le contraire en Tunisie, au motif que la protestation ne pose plus les mêmes problèmes qu’avant la révolution.
La protestation nocturne porte beaucoup de sémiologie notamment, l’anonymat lors des affrontements avec les autorités et la capacité de se démarquer ce qui est à l’inverse des mouvements en Iran dont le but était de manifester en se protégeant par la nuit.
L’acte de protestation a évolué rapidement et de plusieurs manières pour induire toutes les régions pour montrer, ultérieurement, l’incapacité du mouvement à aller de l’avant selon ses méthodes, ses moyens, ses mécanismes et ses objectifs puisqu’il a été infiltré par plusieurs parties et de manière organisée et étudiée.
La manifestation pacifique s’est transformée rapidement en manifestations chaotiques et violentes avec pillage, vol et assaut sur des propriétés privées et publiques pour mener le mouvement lui-même en dehors de l’architecture de base pour laquelle il a été lancé.
Les Organismes officiels et sans compliments ont jeté des accusations à un parti politique en le considérant responsable des événements.
Les médias à leur tour ont largement couvert les événements en mettant en avant le chaos, le pillage et le vol. D’autres parties politiques ont demandé d’imposer un couvre-feu.
La principale et essentielle question était la loi de finances, qui a été annoncée il y a trois mois environ, qui a fait l’objet de litiges et a été approuvée par l’Assemblée du Peuple, malgré les réserves et les nombreux problèmes et la pression de nombreuses parties.
Français Arabe10 ans après – L’échec du libre échange avec l’UE. Ne reproduisons pas les erreurs du passé !
Communiqué de presse 10 ans après – L’échec du libre échange avec l’UE. Ne reproduisons pas les erreurs du passé !
Il y a 10 ans, au 1er janvier 2008, rentrait en vigueur la Zone de Libre Echange (ZLE) entre la Tunisie et l’Union Européenne. En application de l’Accord d’Association de 1995, la suppression des droits de douane sur tous les produits manufacturiers européens entrant en Tunisie était achevée. Il est aujourd’hui primordial de connaitre les conséquences de cette politique sur le pays. Aucune évaluation complète de l’Accord d’Association n’a été réalisée à ce jour. Nous demandons donc une évaluation indépendante et approfondie, commandée par l’Etat tunisien, sur les conséquences pour les tunisiens de l’Accord d’Association avec l’UE. Et ce par rapport aux objectifs qu’il s’était fixés, en termes de conséquences pour les droits économiques, sociaux et environnementaux, et en prenant en compte les inégalités sociales et territoriales. D’ores et déjà, et bien que plusieurs facteurs aient influencé ces évolutions, il faut rappeler que depuis le début de la mise en œuvre de l’accord d’association : – L’équivalent du salaire de 60 000 professeurs a été perdu à cause de la baisse des droits de douane, soit 2,4% du PIB ou 1/10eme du revenu de l’Etat. Cette baisse de revenus a été compensée par des hausses d’impôts, que les tunisiens ont directement ressentie. – 55% du tissu industriel tunisien a été perdu entre 1996 et 2013. – Le chômage n’a pas diminué et a explosé pour les jeunes diplômés. L’économie tunisienne s’est en effet spécialisée dans des activités à faible valeur ajoutée.
– La croissance de l’économie n’a pas dépassé le plafond des 5%. – La ZLE n’a pas eu un impact significatif sur les exportations vers l’UE mais a significativement augmenté les importations. La balance commerciale s’est fortement dégradée. – Les investissements étrangers se sont concentrés sur le littoral, aggravant les inégalités territoriales, sous un régime offshore permettant de rapatrier les bénéfices en Europe.
Depuis 2015, l’Union Européenne presse la Tunisie à négocier un nouveau traité de libre-échange, l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA). Cet ALECA concernerait tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, l’énergie ou les services, secteurs essentiels de l’économie tunisienne. Or ces derniers, notamment l’agriculture, ne semblent pas être en mesure de faire face à la productivité européenne, 7 fois supérieure dans le cas d’une agriculture massivement subventionnée. Une telle ouverture pousserait la Tunisie à se spécialiser dans des produits d’exportation, et à être totalement dépendante des importations européennes. Cela pourrait signifier de nombreuses pertes d’emplois en Tunisie, alors que le chômage est un problème essentiel. D’autant que l’ouverture des marchés tunisiens aux entreprises étrangères ne sera pas soumise à l’obligation de recruter le personnel localement, de soutenir le tissu industriel local, ou encore de transférer les technologies. L’accord donnerait aussi plus de droits aux entreprises étrangères, en conditionnant les futures politiques publiques tunisiennes à la protection de leurs investissements, au détriment de mesures de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être social. Enfin, les négociations n’incluent pas la facilitation de la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, alors qu’elle est à la fois un droit fondamental et indispensable pour assurer des opportunités aux tunisiens en Europe.
Le projet d’ALECA représente donc un risque pour la situation économique et sociale en Tunisie, pour les droits des citoyens tunisiens et pour la souveraineté du pays. En ce jour anniversaire, nous alertons la société civile, les citoyens tunisiens ainsi que ses représentants à être conscients des problèmes du libre-échange, à demander une évaluation approfondie de l’Accord d’Association et à se mobiliser contre le projet d’ALECA proposé par l’Union Européenne. Nous répétons notre attachement à la souveraineté des peuples, à leur liberté, à leurs droits à la dignité, à l’emploi, à la libre circulation et à un environnement sain.
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux Le président Messaoud Romdhani
OST: Rapport décembre 2017
Rapport de l’Observatoire Social Tunisien
Décembre 2017
Le classement de la Tunisie parmi les dix premiers pays du monde, considérés comme des lieux d’évasion fiscale a engendré de nombreuses protestations de la part de différentes parties : la partie gouvernementale a protesté contre ce classement et a estimé que le dossier était vicié et nécessite une révision et un suivi ainsi que l’intention des autorités tunisiennes expertes de mettre un terme à ces fausses allégations et à la campagne de dénégation que subit la Tunisie surtout durant cette période économique critique.
De nombreux acteurs de la société civile ont exprimé leur inquiétude à propos de cette classification, qui aggrave les difficultés économiques, certains d’entre eux reprochant explicitement aux autorités diplomatiques responsables de ne pas avoir fait le nécessaire auparavant.
Les organisations nationales, à leur tour, ont protesté et considéré la question comme une erreur et une grande injustice, certaines se demandent qui est derrière et cherche à nuire à la Tunisie et à sa révolution.
Des parties parlementaires ont, presque, eu les mêmes positions que les protestataires.
Les médias se sont concentrés principalement sur ce sujet et y ont alloué de nombreux dossiers. Il y a beaucoup d’efforts diplomatiques pour revoir cette classification et, selon certains médias, le président français a promis d’examiner et de décider en la matière à la fin de janvier 2018.
Ce qui a été observé sur terrain, c’est que l’impact de ce classement n’a pas eu grands échos dans les espaces publics, dans les villes ou les délégations il y aurait même un amalgame de compréhension du classement de la Tunisie en paradis fiscal puisque ceci n’a aucune relation avec les investisseurs étrangers, ni du système fiscal, ni de la règlementation fiscale ni de la politique de promotion de l’investissement.
Ce qui a été échangé durant des années sur l’évasion fiscale, la corruption et les soupçons de corruption était l’élément le plus important selon l’opinion publique.
Un grand nombre de lectures dans la rue et observées reliant le retard et les lacunes des diverses structures qui relèvent la corruption. Le sujet est devenu du quotidien de la majorité avec des messages, en dépit d’être contradictoires, ils reconnaissent que la lutte contre la corruption est une priorité essentielle et que la l’état de l’économie, de la société et de l’administration sont les otages du succès dans la lutte contre la corruption.
Français Arabe