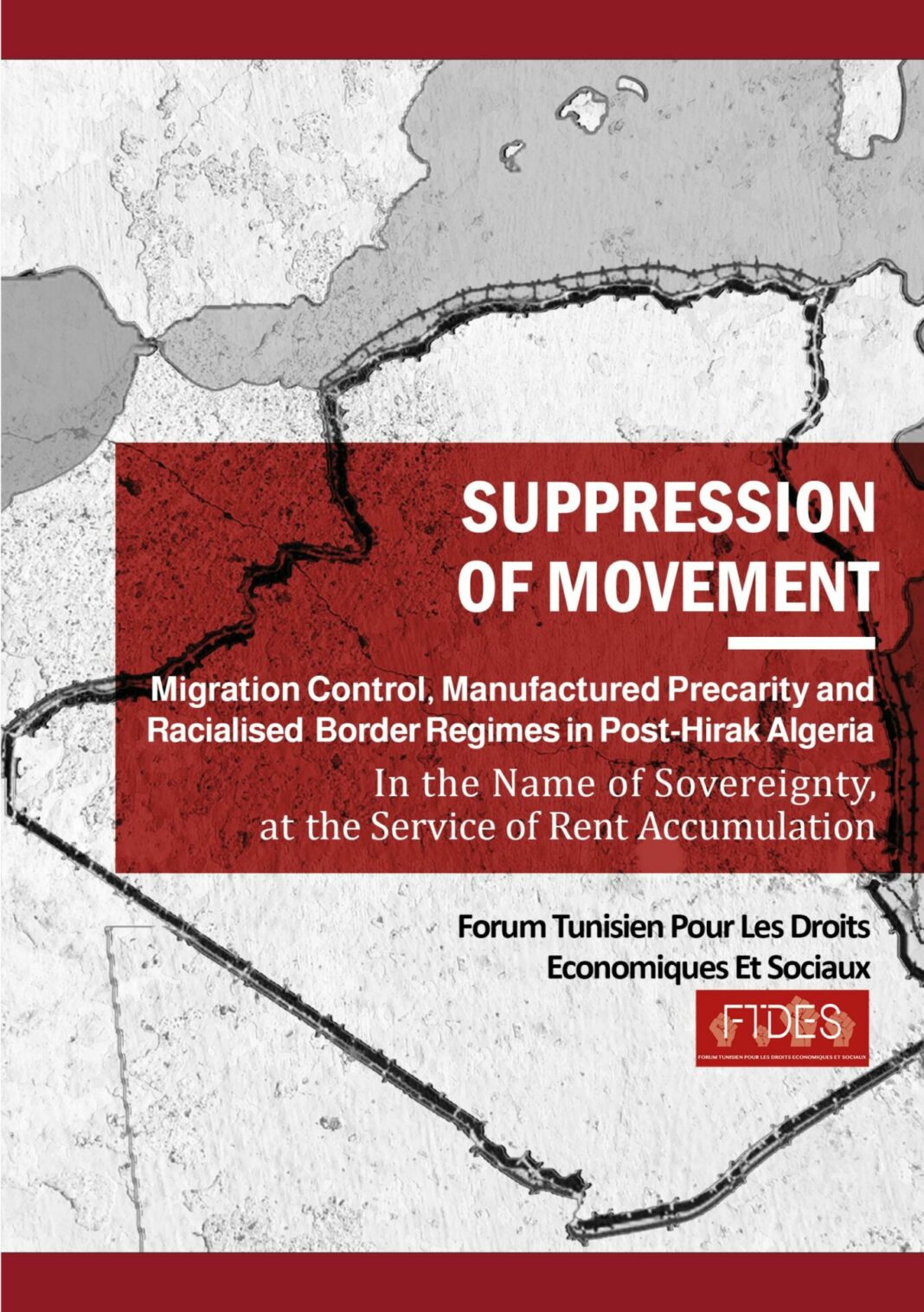Répression de la mobilité
Contrôle de la migration, précarité fabriquée et régimes frontaliers racialisés dans l’Algérie post-Hirak : au nom de la souveraineté, au service de l’accumulation de rentes
« Aujourd’hui, nous pouvons tout faire, à condition de ne pas imiter l’Europe, à condition de ne pas être obsédés par le désir de rattraper l’Europe. L’Europe vit aujourd’hui à un rythme si fou, si imprudent, qu’elle a perdu tout repère, toute raison, et qu’elle court à toute vitesse vers l’abîme ; nous ferions bien de l’éviter à toute vitesse. »
— Frantz Fanon, 1961
Ces dernières années, les autorités algériennes ont considérablement durci leurs politiques (anti-)migratoires. Les refoulements vers la Tunisie et les expulsions massives vers le Niger se sont multipliés, tandis que l’État expulse de plus en plus de personnes vers la Libye et le Maroc. L’image d’une « nouvelle Algérie » prospère, propagée par le régime post-Hirak, est toutefois largement contredite par le nombre croissant d’Algériens harraga qui préfèrent à nouveau risquer la migration clandestine plutôt que de rester dans le pays.
Dans le passé, l’Algérie, contrairement à ses voisins, était considérée comme extrêmement réticente à s’intégrer officiellement dans le régime frontalier européen, refusant presque systématiquement de participer aux projets de « gestion des frontières » financés par l’Europe. Sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune et du chef d’état-major Said Chengriha, l’État a cependant amorcé un revirement prudent, intensifiant sa coopération (anti-)migratoire avec l’Allemagne, l’Italie, l’OIM et la Ligue arabe, notamment en matière de formation policière et de collaboration en vue d’expulsions.
Les représailles de l’État contre les harraga, la précarité artificielle imposée à des milliers de personnes et le racisme systémique (re)produit par l’État et par une grande partie de la société contrastent fortement avec le passé anti-impérialiste de l’Algérie. Le régime continue d’entretenir une image politique nourrie par l’esprit de l’Algérie postcoloniale des années 1960 et 1970. Pourtant, dans les faits, il ne subsiste que des traces de cet alignement autrefois affirmé avec le Sud global. La solidarité internationale que l’État algérien exprime parfois apparaît aujourd’hui conditionnelle et sélective, motivée par les luttes internes au régime pour l’accès aux rentes des hydrocarbures et, au mieux, par des « stratégies anti-impérialistes » de politique étrangère.
Le contrôle des migrations est devenu un enjeu omniprésent dans les discours publics et les interventions gouvernementales à travers l’Afrique du Nord. Toutefois, la situation algérienne reste largement méconnue. Ce rapport vise donc à contribuer à combler cette lacune en dressant un état des lieux des mesures répressives prises par l’État à l’encontre des harraga algériens et non algériens, des infrastructures de rétention mises en place par les autorités, des pratiques d’expulsion des services de sécurité, ainsi que de l’engagement de l’Algérie auprès de gouvernements étrangers dans la répression des mobilités migratoires. À cet égard, la coopération de l’Algérie avec la Tunisie, la Libye, l’Italie, l’Allemagne, mais aussi avec l’OIM, le HCR, la Ligue arabe et son « organisme scientifique », l’Université arabe Naif pour les sciences de la sécurité (NAUSS) basée à Riyad, revêt une importance particulière.
Répression de la mobilité
Contrôle de la migration, précarité fabriquée et régimes frontaliers racialisés dans l’Algérie post-Hirak : au nom de la souveraineté, au service de l’accumulation de rentes
« Aujourd’hui, nous pouvons tout faire, à condition de ne pas imiter l’Europe, à condition de ne pas être obsédés par le désir de rattraper l’Europe. L’Europe vit aujourd’hui à un rythme si fou, si imprudent, qu’elle a perdu tout repère, toute raison, et qu’elle court à toute vitesse vers l’abîme ; nous ferions bien de l’éviter à toute vitesse. »
— Frantz Fanon, 1961
Ces dernières années, les autorités algériennes ont considérablement durci leurs politiques (anti-)migratoires. Les refoulements vers la Tunisie et les expulsions massives vers le Niger se sont multipliés, tandis que l’État expulse de plus en plus de personnes vers la Libye et le Maroc. L’image d’une « nouvelle Algérie » prospère, propagée par le régime post-Hirak, est toutefois largement contredite par le nombre croissant d’Algériens harraga qui préfèrent à nouveau risquer la migration clandestine plutôt que de rester dans le pays.
Dans le passé, l’Algérie, contrairement à ses voisins, était considérée comme extrêmement réticente à s’intégrer officiellement dans le régime frontalier européen, refusant presque systématiquement de participer aux projets de « gestion des frontières » financés par l’Europe. Sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune et du chef d’état-major Said Chengriha, l’État a cependant amorcé un revirement prudent, intensifiant sa coopération (anti-)migratoire avec l’Allemagne, l’Italie, l’OIM et la Ligue arabe, notamment en matière de formation policière et de collaboration en vue d’expulsions.
Les représailles de l’État contre les harraga, la précarité artificielle imposée à des milliers de personnes et le racisme systémique (re)produit par l’État et par une grande partie de la société contrastent fortement avec le passé anti-impérialiste de l’Algérie. Le régime continue d’entretenir une image politique nourrie par l’esprit de l’Algérie postcoloniale des années 1960 et 1970. Pourtant, dans les faits, il ne subsiste que des traces de cet alignement autrefois affirmé avec le Sud global. La solidarité internationale que l’État algérien exprime parfois apparaît aujourd’hui conditionnelle et sélective, motivée par les luttes internes au régime pour l’accès aux rentes des hydrocarbures et, au mieux, par des « stratégies anti-impérialistes » de politique étrangère.
Le contrôle des migrations est devenu un enjeu omniprésent dans les discours publics et les interventions gouvernementales à travers l’Afrique du Nord. Toutefois, la situation algérienne reste largement méconnue. Ce rapport vise donc à contribuer à combler cette lacune en dressant un état des lieux des mesures répressives prises par l’État à l’encontre des harraga algériens et non algériens, des infrastructures de rétention mises en place par les autorités, des pratiques d’expulsion des services de sécurité, ainsi que de l’engagement de l’Algérie auprès de gouvernements étrangers dans la répression des mobilités migratoires. À cet égard, la coopération de l’Algérie avec la Tunisie, la Libye, l’Italie, l’Allemagne, mais aussi avec l’OIM, le HCR, la Ligue arabe et son « organisme scientifique », l’Université arabe Naif pour les sciences de la sécurité (NAUSS) basée à Riyad, revêt une importance particulière.

 العربية
العربية English
English