Zoé Vernin
Janvier 2017, des habitants d’une petite ville près de Sousse démarrent l’année avec une assignation de la garde nationale à venir répondre aux chefs d’accusations d’une plainte déposée le 31 décembre 2016 à l’encontre de la coordination locale de protection de l’environnement. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le propriétaire de l’usine dont les pollutions dévastent Kalaa Sghira s’en prend à ceux qui dénoncent les atteintes à la santé et à l’environnement.

Mercredi 25 janvier, il est environ 17h30 à Kalaa Sghira, et « c’est le clair-obscur » comme le dit si bien Krifa.
Une briqueterie qui désole et révolte les habitants
 o
o
Anis a demandé au louage – taxi collectif depuis Tunis – de me déposer à la sortie de l’autoroute pour me récupérer. Avec Ajmi, ils tiennent à commencer par me faire un tour en voiture, histoire de planter le décor : légèrement vallonné, l’urbanisation y est effectivement très dense. Parsemée d’habitations et d’universités, la zone comprend également un stade olympique et un hôpital universitaire.
L’usine fait très exactement la frontière entre Sousse capitale du Sael, et à l’ouest Kalaa Sghira, ville d’environ 40 000 habitants.
Ajmi m’explique que le vent dominant selon les saisons souffle tantôt sur Sousse, tantôt sur Kalaa Sghira. En ce moment c’est l’hiver, et c’est davantage sur Sousse que les fumées grises se répandent et se maintiennent dans les endroits les plus enclavés.

Néanmoins, la pollution de la Briqueterie Kalaa Sghira – dite BKS – resterait jusqu’à présent « une problématique kaléenne ». A Sousse, « les habitants en auraient moins conscience sans doute par manque de visibilité » selon Ajmi. Il est vrai que les hauts immeubles de la grande ville ont la fâcheuse tendance à cacher ses quatre cheminées fumantes.
 Précisons au cas où, qu’à la BKS on fabrique des briques à base d’argile. Si on se fie à la page wikipédia de Kalaa Sghira, c’est « le plus grand site de fabrication de briques de Tunisie ».
Une poussière rouge teinte d’ailleurs les bords de la route qui finit par nous y conduire. Derrière les murs – en brique – de l’usine, une montagne d’argile culmine en plein air, une manière de stocker sa matière première.
Précisons au cas où, qu’à la BKS on fabrique des briques à base d’argile. Si on se fie à la page wikipédia de Kalaa Sghira, c’est « le plus grand site de fabrication de briques de Tunisie ».
Une poussière rouge teinte d’ailleurs les bords de la route qui finit par nous y conduire. Derrière les murs – en brique – de l’usine, une montagne d’argile culmine en plein air, une manière de stocker sa matière première.
« A Kalaa, tout le monde vous le dira …»
On s’arrête devant la maison d’Anis, qui fait face à la BKS. Il l’a quitté temporairement car dernièrement, sa fille âgée d’à peine quelques mois a commencé à avoir des difficultés respiratoires.

Anis me fait entrer. Il m’explique que l’atmosphère y est toujours très humide à l’intérieur car il ne peut jamais l’aérer. Toutefois, à voir les traces noires sur les rideaux blancs qui dessinent le contour des fenêtres, cela n’empêche pas complètement l’air de s’infiltrer. Anis insiste sur les effets psychologiques de la pollution due aux fumées, et des contraintes que cela génère sur son lieu de vie : « C’est le sentiment d’être enfermé qui domine, et d’être abandonné aussi. On ne vaut rien aux yeux de ce gouvernement ».
Anis fait parti des activistes contre qui le propriétaire de la BKS a porté plainte mais je l’apprendrais un peu plus tard, car il tenait d’abord à laisser d’autres voix s’exprimer.
 Anis commence donc par me présenter son voisin Swaya, agriculteur et éleveur. L’usine surplombe sa maison et ses terres qui comptent environ 270 oliviers, et quelques cultures de grenadiers et de fenouille. Il n’est plus possible de faire pousser du persil, des épinards ou des oignons au pied des oliviers comme autrefois.
Anis commence donc par me présenter son voisin Swaya, agriculteur et éleveur. L’usine surplombe sa maison et ses terres qui comptent environ 270 oliviers, et quelques cultures de grenadiers et de fenouille. Il n’est plus possible de faire pousser du persil, des épinards ou des oignons au pied des oliviers comme autrefois.
La terre est devenue rouge et craquelée : « Elle est recouverte de l’argile que le vent dépose. Et elle n’absorbe désormais plus l’eau ».
On traverse ses terrains, et on s’arrête à la hauteur de la colline d’argile, Quatre oliviers sont morts cette année.

Avec son frère, Swaya a une fois essayé de demander une aide matérielle au propriétaire de l’usine pour assainir ses terres. En vain. Aujourd’hui, il envisage de changer d’activité. Qu’adviendra-t-il de ses parcelles agricoles si personne n’a les moyens d’affronter les couches argileuses ?
Un peu plus loin, on rencontre aussi Selem qui à l’habitude de faire paitre ses moutons en contrebas de la briqueterie. Lorsqu’on évoque le sujet de l’usine, il nous dit que certains de ses agneaux sont déjà morts intoxiqués après s’être nourris de la végétation environnante. Il accuse la BKS dans laquelle il a d’ailleurs travaillé 28 ans.

Tous les kaléens que nous avons rencontré au hasard de notre visite des alentours, expriment des gènes et des inquiétudes quant à la pollution de l’air. Dans le quartier d’à coté, les ouvrières du textile en pause déjeuner, témoignent que « l’odeur est en permanence suffocante ». Alaya, un habitant, précise que « vers 18-19 heures, on ne voit plus rien à cause des fumées qui deviennent noires, noires comme les murs de nos maisons ».
 o
o
Pour Habib, garagiste situé en face de l’usine, « à Kalaa, on est tous malade, et on meurt tous bichwaïa, bichawaïa – petit à petit ».
o
o
o
o
Pour Habib, garagiste situé en face de l’usine, « à Kalaa, on est tous malade, et on meurt tous bichwaïa, bichawaïa – petit à petit ».
o
o
Même si la causalité entre la pollution et les maladies est souvent difficile à démontrer sans réserve, Issam, médecin à Kalaa, n’a pas de doute sur les effets des fumées sur la santé. Ayant travaillé à l’hôpital CHU Farhat Hached de Sousse, il sait que « Kalaa est la ville où le taux de cancers est le plus élevé de tout le Grand Sousse ». Il y a ainsi beaucoup de cancers des poumons et du sang, ainsi que des cancers du sein chez les femmes, et des cancers de la vessie chez les hommes. Malgré tout, rares sont ceux qui parlent de leur maladie, ce qui retarde selon lui une prise de conscience sur l’ampleur du phénomène. Effectuant des visites à domicile à Kalaa Sghira notamment dans les quartiers les plus exposés, il a aussi « régulièrement l’occasion de constater le développement important d’allergies cutanées et respiratoires chez les habitants ». Il n’est d’ailleurs pas le seul de sa profession à s’en inquiéter. Une pétition signée par environ cinquante médecins de la région en 2016 est venue condamner les impacts de l’usine sur la santé.

Leur diagnostic peut aussi s’appuyer sur les résultats d’une inspection sanitaire réalisée par les services publics régionaux de santé en août 2015 à la suite d’une demande des habitants. Dans le périmètre spécifique de la briqueterie, l’équipe était venue pendant deux jours relever les taux de concentration des polluants les plus néfastes pour la santé : ceux que les alvéoles pulmonaires retiennent le plus, provoquant ainsi des maladies cardio-vasculaires. Les résultats ont manifestement donné raison aux habitants qui observaient une différence entre les émissions journalière et nocturnes. En journée, la concentration de certains polluants enregistrée a pu être 67 fois plus élevée que le volume autorisé, tandis que la nuit elle a pu dépasser ce volume légal de 85 fois. La hauteur insuffisante des cheminées avait été identifiée comme une des causes principales de la surexposition des habitants. L’équipe avait tenue aussi à spécifier en fin de rapport avoir elle-même ressentie pendant ces deux jours « des irritations dans les yeux et le nez, des maux têtes et un goût étrange dans la bouche ».
« Notre seule revendication, c’est la dépollution ! »
Yemen m’explique que « la mobilisation contre la pollution a commencé au départ avec quelques personnes. Et puis avec des organisations de la société civile, une dynamique s’est mise en place à partir de 2013, très vite rejoint par des syndicats et des partis politiques ». Yemen est le coordinateur de cette délégation informelle qui se réunit environ tous les mois, voire plus selon les circonstances. La coordination locale de protection de l’environnement a lancé une pétition en 2016 qui a recueilli des milliers de signatures. Elle condamnait l’usine et réclamait des solutions de dépollution.
Enfin, elle est aussi à l’initiative de l’organisation des deux marches du 16 juin 2015 et du 7 mai 2016, qui ont réunit quelques milliers de kalléens.

Manifestation en 2016
Yemen me montre le communiqué datant du 10 mai 2016 qui a été rédigé au lendemain de la dernière marche. Ce communiqué revient sur les revendications du mouvement, notamment « le refus de la fermeture de la briqueterie » en premier point, suivi de l’exigence de « solutions pour arrêter la pollution ». Parmi les signataires et membres de la délégation, il y a l’association Voix des jeunes de Kalaa Sghira, l’Union des agriculteurs, l’association Olive, la section locale de la LTDH, deux syndicats d’enseignements et un syndicat du personnels de santé de l’hôpital de Sahloul, ainsi que la coordination nationale des jeunes pharmaciens. Les partis politiques locaux qui soutiennent sont le parti Ennahda, le Courant démocrate Attayar, le parti Afek Tounes et enfin le Front Populaire. Il y a également l’association SOS BIAA basée à Tunis et dont le soutien vaudra à son président Morched, d’être compris dans les cibles de la plainte du 31 décembre 2016 aux cotés d’autres membres de la coordination. Enfin, il y a l’association UNIVERT qui a été créé en 2016 par Yemen (son président), Anis, Ajmi, Krifa, Hacem et Lotfi que j’ai rencontré, ainsi que neuf autres personnes.
Un proverbe arabe pourrait aujourd’hui résumer les actes du propriétaire de la BKS à leur encontre : ضربني وبكي سبقني وشك
Nous y reviendrons…
Moyens artisanaux, productions industrielles : l’usine hors-la-loi

L’usine n’a pas toujours été ce qu’elle est actuellement. A sa création dans les années 1980, il s’agissait d’une fabrication artisanale de briques : moins de rendement, moins de cheminée et donc beaucoup moins de nuisances. Elle tournait seulement à 6 à 8 heures par jour quand aujourd’hui, la production se poursuit 24heures/24 et 7 jours/7.
Bien que l’usine s’est progressivement développée avec le temps, c’est à la suite d’un changement de propriétaire à la fin des années 2000’s que le rythme de la production a commencé à vraiment s’emballer… Et la briqueterie ne s’en donnera pas vraiment les moyens adéquats. Son agrément d’artisan initial n’est d’ailleurs plus valable, ce qui la rend « illégale » selon Ajmi. Yemen, me montre pour preuve une correspondance du ministère de l’industrie à destination du propriétaire de l’usine, lui signalant en 2016 l’absence d’autorisation officielle pour exercer ses activités industrielles.
Un ouvrier de l’usine a accepté de témoigner anonymement. Il y travaille depuis quelques temps déja. Les conditions de travail sont éprouvantes pour les 400 ouvriers qui travaillent dans la poussière sans masque, et dont la moitié serait à l’âge d’être à la retraite. Certains endroits de l’usine sont très obscurs et étouffants. Cela leur arrive de discuter des maux qu’ils partagent, en particulier des difficultés respiratoires et des troubles digestifs. Il décrit la phase où les wagons d’entassement des briques passent dans les fours, comme particulièrement dangereuse à cause d’un matériel peu adapté à la cadence imposée. En effet, les briques restent à peinent 15 minutes. Et la vitesse des bruleurs serait effectivement augmentée la nuit et les week-ends pour diminuer le temps de cuite à 10 minutes.
C’est bien l’inadéquation entre les moyens matériels et les rendements poursuivis qui contribue ainsi largement à la pollution. Anis se désespère des tentatives de concertation entre les autorités locales, la société civile et l’usine : « Dès qu’on lui adresse le problème et qu’on la presse, l’usine fait des promesses qu’elle ne tient pas. Les autorités savent que la population souffre mais elles ne font rien. Mon pays me déçoit quand il se rend ainsi complice du pollueur ».
L’affaire est en effet tout sauf inconnue des autorités et de ses administrations. Des rapports existent et une procédure administrative sur l’usine est même en cours.
L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement : une alliée sur le(s) papier(s), et dans les faits ?
Constater
Nous nous sommes rendus au siège de la délégation de Kalaa Sghira (échelon administratif intermédiaire entre la municipalité et le gouvernorat). J’ai pu ainsi rencontrer le maire et délégué de Kalaa Sghira Hammadi Al Abib pour discuter du rôle que pouvait jouer les autorités dans le cas d’un conflit entre usine et la population due à la pollution.
 o
o
Pour lui, « il s’agit d’abord de constater la pollution. Cela a été réalisé par les techniciens et ingénieurs de l’Etat dans le cadre de deux rapports de mesure réalisés en 2014 et 2015 par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE)».
oOn peut lire dans ces deux rapports qu’il s’agit à chaque fois « d’une campagne de mesure menée à la briqueterie de Kalaâ Sghira dans le cadre de la surveillance routinière des émissions atmosphériques industrielle sur tout le territoire Tunisien. Elle a comme objectif de vérifier le respect de la règlementation tunisienne (décret 2519-2010 du 28 septembre 2010), et de sensibiliser l’industriel pour réduire ses émissions en cas de dépassement des valeurs limites autorisées ».
Les mesures des émissions de chaque four (4) en 2014 et d’un four en 2015 enregistrent des dépassements systématiques et ahurissants des valeurs limites fixées par le décret de polluants atmosphériques comme le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde souffre (SO2), ou même parfois l’oxyde d’azote (NOx). A titre d’exemple en 2014, on peut constater un taux moyen de CO 67 fois plus élevé que la valeur limite pour le Four B3, et un taux de SO2 presque 6 fois plus élevé pour le four B2.
Evaluer
Le maire poursuit : « Après le constat, il y a bien entendu la nécessité de stopper cette pollution ». Dans ce sens, les conclusions des rapports de l’ANPE ne manquaient pas de propositions. La teneur de certains composés dans la matière première comme le souffre nécessite des méthodes de dépollution, comme par exemple un système d’absorption par le calcaire. La réduction des émissions de poussières serait possible par l’installation de systèmes de filtres à manches, etc.
L’ANPE a commencé par suivre une proposition contenue dans le rapport de 2015, a savoir « faire une étude de dépollution ».
Monsieur Al Abib me précise « qu’une étude a donc été conduite par l’usine via un bureau d’étude, puis validée par l’ANPE. A partir de là, les deux parties (briqueterie et ANPE) se sont alors mutuellement fixés des obligations et un calendrier ».
Astreindre
« Cette convention » signée par l’ANPE et le propriétaire de la BKS au 1er Août 2016, a été découvert par les militants de Kalaa Sghira un mois plus tard alors qu’ils s’apprêtaient déposer une plainte auprès de l’ANPE à Tunis. L’ANPE régionale ne s’était jamais montrée très disposée à prendre en charge les revendications.
Trois délais pour au total six actions ont été fixés entre la signature en aout 2016 et la fin du protocole en Juin 2018.

L’usine s’était déjà engagée à réaliser trois actions d’ici fin novembre 2016 : planter des arbres dans le périmètre de l’usine, couvrir l’argile transportée via des tapis roulants et enfin agrandir le mur qui l’entoure afin qu’aucun amas d’argile ne dépasse. Le maire a accompagné la première visite de contrôle de l’ANPE en décembre. Il avoue « avoir constaté que seules deux des obligations sur les trois ont été respectées car pour l’instant le mur n’a pas bougé. L’ANPE a effectué une deuxième visite « surprise » en janvier et bien que rien n’ait été entrepris dans ce sens, l’agence a rapporté au ministère que toutes les obligations avaient été respectées. La fait que l’ANPE soit à la fois partie à la convention et l’institution du contrôle est en cela un problème, elle seule peut interpréter, et édicter des sanctions en cas de non respect ». Yemen me montre la photo d’une plaque métallique d’environ un mètre sur deux que l’usine a rajouté sur le mur et qui lui aurait permis de « gagner la confiance » des inspecteurs quant à la réalisation prochaine de son engagement. Une anecdote parmi d’autres qui en dit un peu sur la mauvaise foi voire le cynisme dont le propriétaire peut faire preuve vis-à-vis du mouvement.
Le maire évoque enfin également l’existence d’une note de l’ANPE sur les préparatifs en vue du deuxième délai fin février 2017, consistant à élever la taille des cheminées : « Comme le note l’ANPE, c’est matériellement et techniquement très compliqué et peu probable qu’en l’état de fait, cela soit fait dans les temps ». Les militants se disent aussi être très peu optimistes quant au respect de l’une des échéances les plus importantes pour la santé des habitants.
Le contrat qui lie l’usine et l’ANPE, prévoit une dernière échéance fin février 2018. L’usine a donc un an pour installer des filtres à manches dans ses cheminées, et même un mécanisme interne pour mesurer continuellement ses dégagements gazeux. Enfin, il est écrit que si l’usine n’assume pas ses responsabilités, l’ANPE pourra être amenée « à prendre les mesures nécessaires » à partir de juin 2018. Alors à Kalaa Sghira, on attend de voir.
Mais si seulement il suffisait pour le mouvement de suivre ces étapes et veiller aux retards ou distorsions de la mise en œuvre du protocole de dépollution…
Quand l’inédit rime dangereusement avec l’ironie : le pollueur poursuit ses victimes
Des plaintes individuelles étaient déjà tombées au lendemain de la manifestation du 7 mai dernier. « Le propriétaire de l’usine avait tenu à faire savoir qu’il jugeait en quelque sorte Lotfi, Krifa et Malek coupables de semer le désordre » résume Yemen. Chacun avait reçu un coup de téléphone de la garde nationale les invitant à répondre aux motifs de leur accusation. Krifa me raconte : «en ma qualité de directeur d’école, j’étais notamment accusé d’avoir mobiliser les enfants présents à la marche ». Lotfi pour sa part, avait été tenu responsable de « certains slogans scandés par des manifestants ayant soi-disant touché à la dignité du propriétaire de l’usine et de son père (ancien propriétaire) ». Plus tard en septembre ce fut au tour de Yemen d’être convoqué par téléphone, au lendemain d’une émission de radio dans laquelle il avait évoqué les obligations de l’usine vis-à-vis de l’ANPE (via la convention). La plainte était notamment fondée sur « une diffusion de fausses informations », « une participation à une coordination secrète » ainsi que sur « une distribution de flyers non autorisés ».
C’est de mémoire que les militants se souviennent des motivations pour le moins farfelues des plaintes du propriétaire de l’usine, car pas une seule fois ne leur fut remis un quelconque document écrit. « Mon dossier est complètement vide ! Nous n’avons eu accès à aucun papier permettant de connaître l’objet exact des plaintes et de sérieusement préparer leur défense » m’explique Yosra, avocate bénévole auprès du mouvement. Yosra détaille les procédures en cours : Lotfi et Krifa ayant déja été entendus par la Garde nationale, leur dossier ont été transmis au procureur du Tribunal de Première Instance de Sousse qui doit désormais décider s’il ouvre ou non une procédure judiciaire. Yosra s’étonne du temps que prend le procureur pour répondre, « d’habitude, cela va beaucoup plus vite ». Malek étant avocat, son dossier est traité par une commission spéciale du tribunal, et Yemen attend toujours une date d’entretien à la garde nationale.

Parmi les militants contre lesquels le propriétaire de la briqueterie a porté plainte, il y a de gauche à droite, Ajmi, Krifa et Hacem, membres de l’association UNIVERT
Mais le propriétaire ne s’est pas arrêté là, dans la mise en œuvre de ce qu’Anis qualifie « d’une stratégie d’harcèlement ». Il s’est ainsi rendu à la police le 31 décembre, et a déposé plainte cette fois-ci contre la coordination locale de protection de l’environnement pour « utilisation de rapports aux informations falsifiées ». Ces rapports ne sont autres que ceux de l’ANPE cités précédemment et sur lesquels le mouvement s’appuie « pour sensibiliser » me précise Yemen. Cela revient à attaquer des activistes en remettant en cause la véracité de données publiques qu’ils utilisent. Et même si « c’est à lui de prouver que les rapports de l’Etat sont faux » comme me le précise aussi le maire, la possibilité de s’attaquer ainsi à des documents officiels pourrait « ouvrir la voie à un précédent dangereux pour la cause environnementale» selon Morched de l’association SOS BIAA. Pour l’instant, seuls Yemen et lui ont été auditionnés dans le cadre de cette accusation collective. En signe de soutien, beaucoup de kaléens étaient venus les accompagner à la garde nationale début janvier. Ce jour-là, les entretiens des 14 autres membres avaient été reportés à une date ultérieure, jusqu’à présent non connue.
En attendant la suite des entretiens et à plus long terme l’examen du procureur, Yosra essaie de constituer un comité d’avocats. Pour elle, les plaintes sont dépourvues de sens et constituent surtout « des moyens d’intimider et de gagner du temps », mais il faut se préparer dans le cas où le tribunal décide de se saisir de l’une ou l’autre, voire de toutes ces affaires.
A vrai dire, il est difficile de savoir si c’est la gravité ou l’absurdité de ces plaintes qu’il faut retenir. Surement les deux. Anis ironise : « Si on se retrouve derrière les barreaux, je demanderais que l’on nous offre une tenue spéciale, une tenue verte » pour rappeler que les militants n’ont fait que défendre pacifiquement leur environnement.
Espérons alors que l’ironie continue de frapper, de sorte à ce que ces plaintes mettent en lumière les manœuvres tyranniques d’un entrepreneur pour détourner l’attention de ses propres délits. A court-terme, il s’agit donc de faire de ces plaintes à la fois des leviers de médiatisation et de soutien nécessaire au mouvement des habitants de Kalaa Sghira pour presser les autorités compétentes à faire primer l’intérêt de tous sur l’intérêt d’un seul.

 o
o
Poème de Krifa,
improvisé dans la voiture, noté à la hâte… Je me souviens du début d’une poésie que j’ai appris quand j’étais petit, elle commençait ainsi :Mon village entouré par les feuillages, on dirait un nid d’oiseau
Mais ça c’était dans le temps, jadis, car de nos jours,
Mon village est entouré par les fumées et les gaz,
On dirait un volcan.
Pour saluer votre visite
J’aspire à un espoir
Quand est-ce qu’une auréole dissipera cette obscurité terne ?
Cette auréole consiste en la publication de cet article qui donnera cet effet :
Dissiper les fumées qui s’abattent sur la vie des autochtones,
C’est-à-dire les Kaléens




 Ce mouvement, « Fermons la SIAPE », tient son leitmotiv de la lutte contre la pollution engendrée par la Société Industrielle d’Acide Phosphorique et d’Engrais (SIAPE), filiale du Groupe chimique tunisien (GCT) et installée depuis 1952 au sud de Sfax. Ce mouvement tel qu’on le connait sous son nom et sa forme actuels est né après la révolution bien que les préoccupations qu’il exprime sont anciennes et vont bien au-delà des impacts liés à l’usine.
Ce mouvement, « Fermons la SIAPE », tient son leitmotiv de la lutte contre la pollution engendrée par la Société Industrielle d’Acide Phosphorique et d’Engrais (SIAPE), filiale du Groupe chimique tunisien (GCT) et installée depuis 1952 au sud de Sfax. Ce mouvement tel qu’on le connait sous son nom et sa forme actuels est né après la révolution bien que les préoccupations qu’il exprime sont anciennes et vont bien au-delà des impacts liés à l’usine. « Le récit régional qui fait de Sfax une ville victime est largement partagé par sa population » m’explique Mohamed, militant de l’association Ecologie verte. Ce n’est pas le premier sfaxien à m’en témoigner et je dois l’avouer, je ne m’attendais pas à une telle trame régionaliste ici. Sous l’angle des disparités territoriales, Sfax est en théorie « du bon coté ». Deuxième pôle démographique après Tunis, Sfax est une ville côtière dont la prospérité économique repose historiquement sur les relations commerciales que facilite son port. Mohamed me rassure, il est vrai que généralement « on retient de cette ville d’ouvriers qualifiés, un sentiment de fierté fondé sur les meilleurs résultats au bac en Tunisie, l’excellence de ses pôles universitaires, une grande implantation d’activités économiques, un taux de chômage très faible comparé aux autres régions tunisiennes, etc. Et c’est vrai aussi que Sfax est connue pour être intéressée par les affaires et pas vraiment par la politique ».
« Le récit régional qui fait de Sfax une ville victime est largement partagé par sa population » m’explique Mohamed, militant de l’association Ecologie verte. Ce n’est pas le premier sfaxien à m’en témoigner et je dois l’avouer, je ne m’attendais pas à une telle trame régionaliste ici. Sous l’angle des disparités territoriales, Sfax est en théorie « du bon coté ». Deuxième pôle démographique après Tunis, Sfax est une ville côtière dont la prospérité économique repose historiquement sur les relations commerciales que facilite son port. Mohamed me rassure, il est vrai que généralement « on retient de cette ville d’ouvriers qualifiés, un sentiment de fierté fondé sur les meilleurs résultats au bac en Tunisie, l’excellence de ses pôles universitaires, une grande implantation d’activités économiques, un taux de chômage très faible comparé aux autres régions tunisiennes, etc. Et c’est vrai aussi que Sfax est connue pour être intéressée par les affaires et pas vraiment par la politique ». Néanmoins, la population se sent payer le prix de la grande implantation d’activités économiques par une dégradation grave et avérée de son cadre de vie et de sa santé. En effet, Sfax est une
Néanmoins, la population se sent payer le prix de la grande implantation d’activités économiques par une dégradation grave et avérée de son cadre de vie et de sa santé. En effet, Sfax est une  La SIAPE et sa montagne de phosphogypses, photo disponible sur
La SIAPE et sa montagne de phosphogypses, photo disponible sur 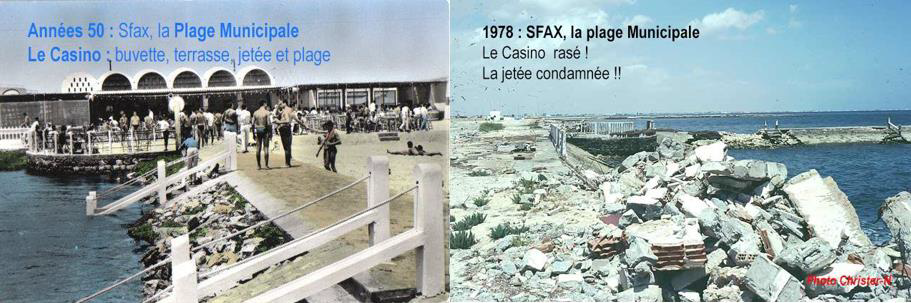 Montage de photos publiées sur
Montage de photos publiées sur 




 Cette initiative est très largement soutenue par les associations et les citoyens. Est formé alors un comité de pilotage « Fermons la SIAPE » (CoPil) chargé d’orienter et coordonner le Collectif Environnement et Développement Durable.
Cette initiative est très largement soutenue par les associations et les citoyens. Est formé alors un comité de pilotage « Fermons la SIAPE » (CoPil) chargé d’orienter et coordonner le Collectif Environnement et Développement Durable. 














 « Le récit régional qui fait de Sfax une ville victime est largement partagé par sa population » m’explique Mohamed, militant de l’association Ecologie verte. Ce n’est pas le premier sfaxien à m’en témoigner et je dois l’avouer, je ne m’attendais pas à une telle trame régionaliste ici. Sous l’angle des disparités territoriales, Sfax est en théorie « du bon coté ». Deuxième pôle démographique après Tunis, Sfax est une ville côtière dont la prospérité économique repose historiquement sur les relations commerciales que facilite son port. Mohamed me rassure, il est vrai que généralement « on retient de cette ville d’ouvriers qualifiés, un sentiment de fierté fondé sur les meilleurs résultats au bac en Tunisie, l’excellence de ses pôles universitaires, une grande implantation d’activités économiques, un taux de chômage très faible comparé aux autres régions tunisiennes, etc. Et c’est vrai aussi que Sfax est connue pour être intéressée par les affaires et pas vraiment par la politique ».
« Le récit régional qui fait de Sfax une ville victime est largement partagé par sa population » m’explique Mohamed, militant de l’association Ecologie verte. Ce n’est pas le premier sfaxien à m’en témoigner et je dois l’avouer, je ne m’attendais pas à une telle trame régionaliste ici. Sous l’angle des disparités territoriales, Sfax est en théorie « du bon coté ». Deuxième pôle démographique après Tunis, Sfax est une ville côtière dont la prospérité économique repose historiquement sur les relations commerciales que facilite son port. Mohamed me rassure, il est vrai que généralement « on retient de cette ville d’ouvriers qualifiés, un sentiment de fierté fondé sur les meilleurs résultats au bac en Tunisie, l’excellence de ses pôles universitaires, une grande implantation d’activités économiques, un taux de chômage très faible comparé aux autres régions tunisiennes, etc. Et c’est vrai aussi que Sfax est connue pour être intéressée par les affaires et pas vraiment par la politique ».


